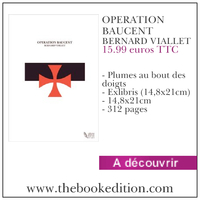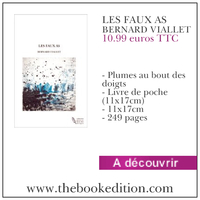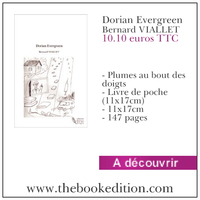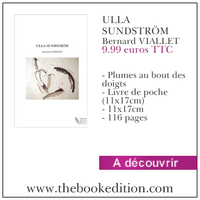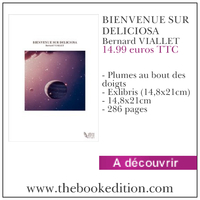18/10/2025
Que d'os ! (J. P. Manchette)
 Une vieille femme d'allure modeste se présente chez Eugène Tarpon pour lui demander son aide. Sa fille, Philippine Pigot, orpheline de père et aveugle de naissance, a disparu mystérieusement. Blonde, jeune et assez jolie, elle vivait chez sa mère à Mantes la Jolie. Elle prenait le train de banlieue cinq jours par semaine pour aller exercer son métier de secrétaire (en braille) pour la Fondation Stanislas Baudrillard à Paris. Un matin de septembre, elle était partie travailler comme d'habitude. Et personne ne l'a vue arriver à son bureau. Tarpon commence par privilégier la thèse de l'enlèvement, la mère lui ayant précisé qu'elle n'avait ni fiancé ni petit ami. Mais un peu plus tard, Tarpon apprend qu'elle serait partie de son plein gré en compagnie d'un jeune homme. Alors, kidnapping ou simple fugue ?
Une vieille femme d'allure modeste se présente chez Eugène Tarpon pour lui demander son aide. Sa fille, Philippine Pigot, orpheline de père et aveugle de naissance, a disparu mystérieusement. Blonde, jeune et assez jolie, elle vivait chez sa mère à Mantes la Jolie. Elle prenait le train de banlieue cinq jours par semaine pour aller exercer son métier de secrétaire (en braille) pour la Fondation Stanislas Baudrillard à Paris. Un matin de septembre, elle était partie travailler comme d'habitude. Et personne ne l'a vue arriver à son bureau. Tarpon commence par privilégier la thèse de l'enlèvement, la mère lui ayant précisé qu'elle n'avait ni fiancé ni petit ami. Mais un peu plus tard, Tarpon apprend qu'elle serait partie de son plein gré en compagnie d'un jeune homme. Alors, kidnapping ou simple fugue ?
« Que d'os ! » est un roman noir mettant en scène une nouvelle fois le détective, ex-gendarme désabusé, Eugène Tarpon, personnage déjà récurrent, mais dont on ne sait encore pas grand-chose. Il mène une enquête assez compliquée, qui part un peu dans tous les sens avant de finir au sein d'une secte aussi ésotérique d'improbable où il devra payer de sa personne. L'histoire ne se situe pas très loin de la parodie de romans d'aventures ou d'espionnage style Bob Morane ou OSS 117. Tout est tellement caricatural et outré que cela en devient presque humoristique. On notera que l'écriture est des plus relâchée, pour ne pas dire bâclée : nombreuses répétitions, style parlé ou écriture au fil de la plume, quasiment sans relecture. L'ensemble peut être considéré comme divertissant, mais le lecteur peut aussi remarquer que cela a assez mal vieilli. Pour moi, ce titre n'est pas finalement le meilleur ouvrage de Manchette.
3/5
09:10 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)
14/10/2025
Les tribulations du dernier Sijilmassi (Fouad Laroui)
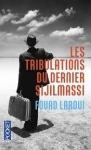 Assis sur son fauteuil dans un avion de la Lufthansa volant au-dessus de la mer d'Andaman à la vitesse folle de 900 km à l'heure, Adam Sijilmassi, ingénieur marocain dans une société de bitume, réalise soudain que courir le monde à pareille vitesse alors que son grand-père ne se déplaçait au mieux qu'à celle d'un Vélosolex n'a aucun sens. Suite à ce qu'il appelle une « Epiphanie », il décide de ne plus jamais reprendre l'avion. Débarqué à l'aéroport de Casablanca, il refuse de prendre le moindre taxi et entreprend de rentrer chez lui à pied en trainant sa valise à roulettes sous le cagnard. Des gens s'arrêtent pour lui venir en aide, pour lui proposer une place dans leur voiture, mais Adam s'obstine dans sa détermination. Il a bien l'intention de remettre en question un à un tous les éléments de sa vie somme toute confortable, mais assez banale et donc insatisfaisante…
Assis sur son fauteuil dans un avion de la Lufthansa volant au-dessus de la mer d'Andaman à la vitesse folle de 900 km à l'heure, Adam Sijilmassi, ingénieur marocain dans une société de bitume, réalise soudain que courir le monde à pareille vitesse alors que son grand-père ne se déplaçait au mieux qu'à celle d'un Vélosolex n'a aucun sens. Suite à ce qu'il appelle une « Epiphanie », il décide de ne plus jamais reprendre l'avion. Débarqué à l'aéroport de Casablanca, il refuse de prendre le moindre taxi et entreprend de rentrer chez lui à pied en trainant sa valise à roulettes sous le cagnard. Des gens s'arrêtent pour lui venir en aide, pour lui proposer une place dans leur voiture, mais Adam s'obstine dans sa détermination. Il a bien l'intention de remettre en question un à un tous les éléments de sa vie somme toute confortable, mais assez banale et donc insatisfaisante…
« Les tribulations du dernier Sijilmassi » est un roman en forme de conte philosophique bien écrit et donc assez agréable à lire. Le thème de la crise de la quarantaine d'un cadre qui veut se libérer de tout ce qu'il estime être des chaînes et tente un retour aux sources, en l'occurrence vers son village natal, l'amène à aller de déceptions en déceptions. C'est très bien vu, finement observé. Les personnages secondaires sont originaux et bien pétris d'humanité. Les pesanteurs sociales sont parfaitement décrites surtout lorsqu'il se retrouve coincé dans un rôle de gourou local qui ne lui convient nullement. Il ira donc jusqu'au bout de sa démarche et le lecteur n'en attendait pas moins. Fouad Laroui est un auteur très imprégné de culture française, mais également de philosophie musulmane. Il émaille son récit de divers développements sur la littérature et la théologie qui voulant remonter le niveau, ralentissent un peu le rythme de la narration. C'est le seul léger reproche à lui faire. Reste un petit côté Giono voire Calvino bien agréable dans cette histoire divertissante et qui donne à réfléchir.
4/5
09:17 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)
11/10/2025
La louve du Cap Spartiventi (Charles Lucieto)
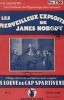 En moins d'un mois, sept splendides cargos récemment sortis des chantiers navals de la Clyde étaient partis en mer de Chine mais n'étaient jamais rentrés au port. Ils servaient comme auxiliaires ou comme transports de troupes et comptaient parmi les plus belles unités de l'escadre britannique que commandait le vice-amiral Wood. Toutes les recherches pour les retrouver ayant été vaines, Sir Harold Kilney, grand patron du Colonial Office, fait appel à l'agent secret James Nobody pour lui confier cette affaire. Celui-ci part immédiatement pour Shangaï accompagnés de ses deux fidèles lieutenants, Bob Harvey et Harry Smith. Mais à peine les trois hommes sont-ils arrivés sur place qu'Harvey disparaît sans laisser de trace et que le bureau de Nobody est cambriolé. Pour ne rien arranger, l'agent secret reçoit une lettre de menaces de mort émanant d'une mystérieuse société secrète chinoise appelée « Les compagnons de la Louve ». Aurait-elle quelque chose à voir avec la disparition des navires anglais et avec celle de son ami ?
En moins d'un mois, sept splendides cargos récemment sortis des chantiers navals de la Clyde étaient partis en mer de Chine mais n'étaient jamais rentrés au port. Ils servaient comme auxiliaires ou comme transports de troupes et comptaient parmi les plus belles unités de l'escadre britannique que commandait le vice-amiral Wood. Toutes les recherches pour les retrouver ayant été vaines, Sir Harold Kilney, grand patron du Colonial Office, fait appel à l'agent secret James Nobody pour lui confier cette affaire. Celui-ci part immédiatement pour Shangaï accompagnés de ses deux fidèles lieutenants, Bob Harvey et Harry Smith. Mais à peine les trois hommes sont-ils arrivés sur place qu'Harvey disparaît sans laisser de trace et que le bureau de Nobody est cambriolé. Pour ne rien arranger, l'agent secret reçoit une lettre de menaces de mort émanant d'une mystérieuse société secrète chinoise appelée « Les compagnons de la Louve ». Aurait-elle quelque chose à voir avec la disparition des navires anglais et avec celle de son ami ?
« La louve du Cap Spartiventi » est un roman d'espionnage plein de rebondissements et de belles valeurs de courage, d'honnêteté et d'esprit chevaleresque comme on n'en écrit plus de nos jours. L'histoire est courte, fort bien écrite dans un style vif et agréable à lire. Le héros est une sorte de James Bond ou d'OSS117 avant l'heure. Bien que la série date de 1929 et reflète l'esprit optimiste de l'époque, c'est encore un plaisir de la découvrir. Le cadre est cette fois la Chine prise dans les soubresauts de l'avant-guerre, essayant de s'affranchir par tous les moyens de la tutelle anglo-saxonne pour parvenir à une certaine indépendance. En sous-main, l'URSS de Staline est à la manœuvre pour financer et manipuler les rebelles organisés en sociétés secrètes fort cruelles et fort inquiétantes. Mais Nobody et son équipe s'en tireront une fois de plus avec honneur et panache. C'est amusant, divertissant et un brin instructif pour la plongée dans cette période troublée de l'histoire secrète du monde.
4/5
08:59 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)
08/10/2025
Au pays de l'épouvante (Charles Lucieto)
 À Londres, dans les années vingt, Lionel Walpool, rédacteur au Daily Magazine, a mystérieusement disparu. Il n'était ni dépressif, ni suicidaire et n'avait donc aucune raison de disparaître. Toutes les recherches engagées sont restées sans le moindre effet. En désespoir de cause, son directeur Sir Horace Londsale demande au célèbre détective James Nobody de s'occuper de l'affaire. C'est le seul homme capable d'assumer pareille mission. Lionel Walpool avait été le seul de sa profession à dénoncer dans ses articles les agissements coupables des bolcheviques russes opérant en Grande-Bretagne, tout particulièrement ceux d'un certain Borodine, ambassadeur officieux de Staline, et surtout agitateur et espion notoire. Celui-ci s'occupait surtout à financer les syndicats ouvriers anglais pour qu'ils déstabilisent à coups de grèves et d'émeutes le gouvernement de sa Majesté et à soulever les Sudistes chinois contre l'Angleterre. Walpool a bien été enlevé et embarqué dans un sous-marin en direction de la Russie. Nobody parviendra-t-il à aller là-bas arracher des mains des tortionnaires de la Tchéka ce malheureux journaliste ?
À Londres, dans les années vingt, Lionel Walpool, rédacteur au Daily Magazine, a mystérieusement disparu. Il n'était ni dépressif, ni suicidaire et n'avait donc aucune raison de disparaître. Toutes les recherches engagées sont restées sans le moindre effet. En désespoir de cause, son directeur Sir Horace Londsale demande au célèbre détective James Nobody de s'occuper de l'affaire. C'est le seul homme capable d'assumer pareille mission. Lionel Walpool avait été le seul de sa profession à dénoncer dans ses articles les agissements coupables des bolcheviques russes opérant en Grande-Bretagne, tout particulièrement ceux d'un certain Borodine, ambassadeur officieux de Staline, et surtout agitateur et espion notoire. Celui-ci s'occupait surtout à financer les syndicats ouvriers anglais pour qu'ils déstabilisent à coups de grèves et d'émeutes le gouvernement de sa Majesté et à soulever les Sudistes chinois contre l'Angleterre. Walpool a bien été enlevé et embarqué dans un sous-marin en direction de la Russie. Nobody parviendra-t-il à aller là-bas arracher des mains des tortionnaires de la Tchéka ce malheureux journaliste ?
« Au pays de l'épouvante » est un roman d'espionnage datant de 1929 et écrit par un ancien des services secrets au courant de nombreuses choses cachées au grand public déjà à l'époque. Sa description des horreurs du Goulag, des tortures pratiquées à la prison de la Loubianka et de la sinistre réalité des camps de concentration de la Kolyma peuvent choquer une âme sensible. Le lecteur s'étonnera qu'il ait fallu presque un demi-siècle de plus pour que les œuvres de Soljenitsyne « L'Archipel du Goulag », « La roue rouge », permettent enfin à la vérité sur le pseudo-paradis communiste d'arriver au jour. Tout avait déjà été décrit chez Lucieto sous une forme « OSS 117 » bien sûr, mais la chape de plomb de mensonge diffusée par une presse aux ordres avait tout caché pendant aussi longtemps. Et il fallut encore attendre « Le livre noir du communisme » de Stéphane Courtois pour que l'ampleur des massacres soit reconnue… Fort bien écrites, pleines de rebondissements et de faits réels, ces aventures se lisent avec plaisir encore aujourd'hui. Le lecteur ferme le livre en regrettant que cela soit si vite terminé. Il a hâte de dévorer la suivante.
4,5/5
08:58 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)
04/10/2025
La peste écarlate (Jack London)
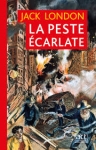 Depuis l'année 2013, la science a été incapable de faire face à une maladie mystérieuse et extrêmement contagieuse capable de faire passer de vie à trépas en quelques heures des humains qui voient leur peau devenir rouge écarlate. En fort peu de temps, la terre s'est retrouvée presque totalement dépeuplée. Les villes ont été détruites. San Francisco, entre autres, a disparu dans des tourbillons de flammes. Démunis de tout, les rares survivants en sont retournés assez vite à l'âge de pierre. Vêtus de peaux de bêtes, ils survivent péniblement d'un peu d'élevage, de chasse et de pêche. Quelques dizaines d'années après la catastrophe, un vieil homme, qui autrefois fut professeur à l'université, raconte à trois jeunes enfants comment les hommes vivaient avant… Au plus froid de l'hiver, il n'est pas prudent de parcourir seul les immenses étendues glacées du Klondike. C'est d'autant plus risqué quand on commence à sentir ses doigts geler et n'être même plus capables de frotter une allumette pour allumer un feu… Loin de tout et manquant de ressources, des chercheurs d'or ont institué une façon radicale d'exercer la justice. En l'absence de prison, tout meurtrier est lancé sur le fleuve sur une barque avec plus ou moins de provisions en fonction de la gravité du crime. Il va sans dire que sans rien, il a fort peu de chance de s'en sortir vivant. Un jour, Marc O'Brien, juge bénévole, se retrouve à son tour dans cette délicate posture suite à une cuite mémorable…
Depuis l'année 2013, la science a été incapable de faire face à une maladie mystérieuse et extrêmement contagieuse capable de faire passer de vie à trépas en quelques heures des humains qui voient leur peau devenir rouge écarlate. En fort peu de temps, la terre s'est retrouvée presque totalement dépeuplée. Les villes ont été détruites. San Francisco, entre autres, a disparu dans des tourbillons de flammes. Démunis de tout, les rares survivants en sont retournés assez vite à l'âge de pierre. Vêtus de peaux de bêtes, ils survivent péniblement d'un peu d'élevage, de chasse et de pêche. Quelques dizaines d'années après la catastrophe, un vieil homme, qui autrefois fut professeur à l'université, raconte à trois jeunes enfants comment les hommes vivaient avant… Au plus froid de l'hiver, il n'est pas prudent de parcourir seul les immenses étendues glacées du Klondike. C'est d'autant plus risqué quand on commence à sentir ses doigts geler et n'être même plus capables de frotter une allumette pour allumer un feu… Loin de tout et manquant de ressources, des chercheurs d'or ont institué une façon radicale d'exercer la justice. En l'absence de prison, tout meurtrier est lancé sur le fleuve sur une barque avec plus ou moins de provisions en fonction de la gravité du crime. Il va sans dire que sans rien, il a fort peu de chance de s'en sortir vivant. Un jour, Marc O'Brien, juge bénévole, se retrouve à son tour dans cette délicate posture suite à une cuite mémorable…
« La peste écarlate » est un recueil de trois nouvelles assez longues qui ont pour cadre le grand nord. La première relève nettement de la science-fiction. C'est une dystopie assez inquiétante sur un thème largement développé ensuite, celui d'une pandémie mortelle dont seuls quelques personnes parviennent à échapper de façon inexpliquée. Le monde redevenu sauvage a tellement changé que les jeunes n'arrivent même pas à imaginer qu'il y avait pu avoir une civilisation avant eux, que l'homme pouvait communiquer sans fil, voler dans les airs et bénéficier d'une vie nettement plus facile que la leur. Les deux autres (« Construire un feu » et « Comment disparut Marc O'Brien ») sont plus réalistes, voire naturalistes. La première fait toucher du doigt la dure réalité de la vie dans le Grand Nord et la seconde, à notre goût la plus réussie des deux, relève presque du conte satirique ou de l'anecdote un brin picaresque avec son côté arroseur arrosé. Inutile d'insister sur le style de grande qualité de London. C'est toujours un plaisir de lire et relire cet auteur qui nous fera toujours rêver de grands espaces, de vie sauvage et de liberté dans un cadre grandiose et souvent hostile…
4,5/5
08:52 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)
01/10/2025
Le capitalisme de la séduction (Michel Clouscard)
 « Quelle est la tenue de rigueur du rigorisme libéral et permissif ? Comment l'animation machinale devient-elle le destin des animaux-machines ? Comment établir que le caché s'étale au grand jour et que l'anodin est révélateur de l'essentiel ? » S'interroge le sociologue marxiste bien en peine de définir l'état réel du capitalisme. « L'objet de notre livre est d'exhausser une intuition et un concept. Nous voulons dire le mondain », précise-t-il. Mais n'est-il pas trop tard ? Le clerc n'a-t-il pas définitivement trahi ? L'intellectuel de gauche, de libidinalité en lucidité, de marginalité en convivialité, n'est-il pas définitivement intégré dans le système, dans le mondain, dans la social-démocratie libertaire ? Pour lui, le capitalisme est protéiforme, évolutif. Il se renouvelle en permanence, se recrée en se contestant lui-même. Nouvelle Hydre de Lerne, il est en auto-destruction et en auto-recréation permanente. D'où la difficulté de le dépeindre et de l'analyser avant même de pouvoir imaginer lutter contre.
« Quelle est la tenue de rigueur du rigorisme libéral et permissif ? Comment l'animation machinale devient-elle le destin des animaux-machines ? Comment établir que le caché s'étale au grand jour et que l'anodin est révélateur de l'essentiel ? » S'interroge le sociologue marxiste bien en peine de définir l'état réel du capitalisme. « L'objet de notre livre est d'exhausser une intuition et un concept. Nous voulons dire le mondain », précise-t-il. Mais n'est-il pas trop tard ? Le clerc n'a-t-il pas définitivement trahi ? L'intellectuel de gauche, de libidinalité en lucidité, de marginalité en convivialité, n'est-il pas définitivement intégré dans le système, dans le mondain, dans la social-démocratie libertaire ? Pour lui, le capitalisme est protéiforme, évolutif. Il se renouvelle en permanence, se recrée en se contestant lui-même. Nouvelle Hydre de Lerne, il est en auto-destruction et en auto-recréation permanente. D'où la difficulté de le dépeindre et de l'analyser avant même de pouvoir imaginer lutter contre.
« Le capitalisme de la séduction » est un essai de sociologie et de philosophie politique qui n'est pas inintéressant, mais qui semble avoir déjà énormément vieilli. Il sent son atmosphère post-soixante-huitarde, ses années Pompidou-Giscard-Mitterrand. Avec le recul dont nous disposons, il est facile de s'apercevoir que les descriptions à base de poster, flipper, moto et juke-box, les archétypes jeans, cheveux longs, guitares électriques, les ambiances contestation, consumérisme exacerbé et débuts de la libération des corps (pilule, hasch, etc.) sont très largement dépassées et semblent même un brin folkloriques voire gentillettes par rapport aux dérives actuelles, parfaitement logiques d'ailleurs. Le style de l'auteur est assez lourd, répétitif, voire redondant. C'est verbeux, filandreux, ça sent fort sa logorrhée universitaire. On est très loin de « ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire en viennent aisément ». Le lecteur a même l'impression que l'auteur se paie de mots, n'a pas vraiment une conception claire de ce qu'il observe et est même déjà dépassé par un phénomène qui bouscule ses certitudes. Il est donc logique qu'il n'ait pas eu plus de clairvoyance sur l'évolution sinistre du capitalisme vers l'ultra-gauchisme, le wokisme, le lgbtisme et le mondialisme. (« Vous ne posséderez plus rien, mais vous serez heureux »). La social-démocratie libérale-libertaire poussivement décrite par Clouscard a évolué en totalitarisme de moins en moins soft, fait de propagande, de pensée unique et de restrictions de plus en plus importantes de la liberté d'expression. Nous sommes passé subrepticement de « Consomme, jouis sans entrave et cause toujours » à « Fais comme tout le monde et surtout ferme-la ! ». Mais cela notre sociologue ne l'avait pas vraiment vu venir…
2,5/5
08:22 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)
28/09/2025
Morgue pleine (Jean-Patrick Manchette)
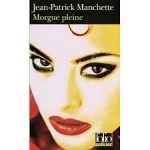 Eugène Tarpon, ancien gendarme et nouveau détective privé, s'apprête à jeter l'éponge faute de clients et à retourner dans sa province, quand il reçoit un certain Alain Lhuillier qui se dit victime de racketteurs. Avec quelques amis, il a monté un petit club de jazz dans la cave d'une ancienne épicerie. Mais comme il rencontre un petit succès, quelques types lui ont demandé de cotiser à une pseudo « Mutuelle des Limonadiers ». Il a refusé. Un ampli a été saboté et les voyous sont revenus à la charge exigeant 25% de la recette. Il a payé, mais voilà que les racketteurs se sont montrés plus gourmands. Ils veulent maintenant rien moins que le double. Tarpon n'accepte pas le job. Mais bien vite il se retrouve avec un premier cadavre sur les bras. Celui d'une certaine Griselda salement égorgée. Elle était actrice dans de petits films pornos. Tarpon soupçonne d'abord sa meilleure amie. Plusieurs enlèvements et quelques assassinats plus tard, il en arrive à une autre explication…
Eugène Tarpon, ancien gendarme et nouveau détective privé, s'apprête à jeter l'éponge faute de clients et à retourner dans sa province, quand il reçoit un certain Alain Lhuillier qui se dit victime de racketteurs. Avec quelques amis, il a monté un petit club de jazz dans la cave d'une ancienne épicerie. Mais comme il rencontre un petit succès, quelques types lui ont demandé de cotiser à une pseudo « Mutuelle des Limonadiers ». Il a refusé. Un ampli a été saboté et les voyous sont revenus à la charge exigeant 25% de la recette. Il a payé, mais voilà que les racketteurs se sont montrés plus gourmands. Ils veulent maintenant rien moins que le double. Tarpon n'accepte pas le job. Mais bien vite il se retrouve avec un premier cadavre sur les bras. Celui d'une certaine Griselda salement égorgée. Elle était actrice dans de petits films pornos. Tarpon soupçonne d'abord sa meilleure amie. Plusieurs enlèvements et quelques assassinats plus tard, il en arrive à une autre explication…
« Morgue pleine » est un roman noir que l'auteur lui-même a présenté comme une œuvre alimentaire, écrite au fil de la plume, à toute vitesse et pour payer ses impôts. Et c'est bien l'impression que le lecteur a en lisant cette histoire assez mal ficelée. On est bien dans une ambiance cinéma glauque américain avec pas mal d'allusions au jazz de l'autre siècle. On aimerait en savoir plus sur Tarpon, mais on reste sur sa faim en se posant des questions. En effet, Manchette a gardé le parti pris de ne décrire que les actions (récurrentes d'ailleurs) et, vaguement, quelques décors, mais pas de contexte psychologique ou autre. Les autres personnages manquent de consistance, de pâte humaine. Ils restent parfaitement archétypaux pour ne pas dire caricaturaux (la pute, le maquereau, le gangster, etc…). On aurait aimé quelque chose de plus travaillé, de moins brut de décoffrage et même avec un brin d'humour et de détachement (la narration à la première personne n'aide pas). Mais faut pas trop rêver ni en demander dans ces conditions. En résumé, pas le meilleur opus du maître…
2,5/5
08:59 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)
24/09/2025
Marie-Antoinette et le complot maçonnique (Louis Dasté)
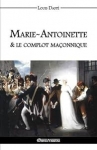 Le 8 juin 1773, Louis XVI encore Dauphin fait son entrée solennelle à Paris en compagnie de sa jeune épouse Marie-Antoinette. L'enthousiasme de la foule envers le couple n'est pas loin du délire. « Madame, vous avez ici deux cent mille amoureux ! » commente le Duc de Brissac. Mais moins de vingt années plus tard, Marie-Antoinette n'est plus que « L'Autrichienne ». Elle est détestée, méprisée, vilipendée encore plus que le Roi lui-même. Que s'est-il donc passé pour en être arrivé à un tel retournement de l'opinion ? Comment a-t-on pu passer de l'amour à la haine et que tout cela finisse en martyre sur l'échafaud ? Pendant toutes ces années, la Franc-maçonnerie avait œuvré à l'aide de centaines de pamphlets, de libelles anonymes distribués dans tout le pays, répandant rumeurs, mensonges et calomnies (la fake news de l'époque en quelque sorte) toujours anonymes et souvent imprimées à l'étranger. Il s'agissait de souiller l'image de la royauté afin de pouvoir plus aisément s'en débarrasser. Et ce fut une totale réussite…
Le 8 juin 1773, Louis XVI encore Dauphin fait son entrée solennelle à Paris en compagnie de sa jeune épouse Marie-Antoinette. L'enthousiasme de la foule envers le couple n'est pas loin du délire. « Madame, vous avez ici deux cent mille amoureux ! » commente le Duc de Brissac. Mais moins de vingt années plus tard, Marie-Antoinette n'est plus que « L'Autrichienne ». Elle est détestée, méprisée, vilipendée encore plus que le Roi lui-même. Que s'est-il donc passé pour en être arrivé à un tel retournement de l'opinion ? Comment a-t-on pu passer de l'amour à la haine et que tout cela finisse en martyre sur l'échafaud ? Pendant toutes ces années, la Franc-maçonnerie avait œuvré à l'aide de centaines de pamphlets, de libelles anonymes distribués dans tout le pays, répandant rumeurs, mensonges et calomnies (la fake news de l'époque en quelque sorte) toujours anonymes et souvent imprimées à l'étranger. Il s'agissait de souiller l'image de la royauté afin de pouvoir plus aisément s'en débarrasser. Et ce fut une totale réussite…
« Marie-Antoinette Antoinette » est essai historique un peu ancien (il date de 1910), mais toujours lisible aujourd'hui. Tout est sourcé, analysé et contextualisé avec sérieux et précision. Un lecteur averti de la plupart des recherches sur la période, remarquera que l'accent est mis surtout sur l'influence délétère des Loges et néglige d'autres causes comme la géopolitique mondiale (indépendance des États-Unis, participation massive de ruineuse de la France à la guerre américaine, rancœur et vengeance de l'Angleterre) sans oublier les problèmes économiques, dette importante, mais ridicule par rapport à ce que deviennent les finances du pays après dix ans de Révolution, participation de la noblesse et même de personnes de la famille royale (Philippe-Egalité), et responsabilité d'autres sociétés secrètes comme les Illuminatis et les Rose-Croix. L'ouvrage montre bien l'incompréhension du couple royal qui considère que la maçonnerie est une « société de bienfaisance et de plaisir » et n'écoute pas les mises en garde du pape Clément XII et du Cardinal de Fleury qui tentent de s'opposer en vain à cette influence. Cette naïveté leur coûtera la vie. De plus, l'analyse se cantonne aux années 1789-90, montrant que la Révolution commence dans le sang dès le 14 juillet 1789 avec de nombreuses émeutes dans tous le pays dès le début de l'année. Toutes lancées simultanément ainsi que des cahiers de doléances ressemblant souvent à des copiés-collés. Intéressant, mais finalement assez incomplet.
3/5
09:03 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)
19/09/2025
Le pouvoirs des trois seaux (Sonia Vincent & Lou Leforestier-Milburn)
 Être parent est tout un art qui s'apprend souvent dans la douleur. Apprendre à le devenir ne s'improvise pas si facilement. Il y faut beaucoup d'amour, d'attention et de dévouement. Ainsi la méthode de Sonia et Lou se propose-t-elle de poser un cadre éducatif bienveillant, c'est à dire non directif, non coercitif et parfaitement respectueux des besoins de l'enfant et du parent. Sinon, on se retrouve avec l'enfant-roi et le parent-esclave ! Cette méthode repose sur un travail de remplissage de trois seaux : celui de l'affectif, celui de l'attention et celui du pouvoir. Il s'agit de prouver à l'enfant que l'amour du parent est inconditionnel, de lui montrer qu'il a de la valeur en validant ses émotions, même les plus intenses et de développer sa confiance en lui en permettant de remplir son seau de pouvoir quoi qu'il arrive. Au parent de savoir faire preuve de fermeté sans rejet, de poser une limite tout en restant bienveillant et à l'écoute…
Être parent est tout un art qui s'apprend souvent dans la douleur. Apprendre à le devenir ne s'improvise pas si facilement. Il y faut beaucoup d'amour, d'attention et de dévouement. Ainsi la méthode de Sonia et Lou se propose-t-elle de poser un cadre éducatif bienveillant, c'est à dire non directif, non coercitif et parfaitement respectueux des besoins de l'enfant et du parent. Sinon, on se retrouve avec l'enfant-roi et le parent-esclave ! Cette méthode repose sur un travail de remplissage de trois seaux : celui de l'affectif, celui de l'attention et celui du pouvoir. Il s'agit de prouver à l'enfant que l'amour du parent est inconditionnel, de lui montrer qu'il a de la valeur en validant ses émotions, même les plus intenses et de développer sa confiance en lui en permettant de remplir son seau de pouvoir quoi qu'il arrive. Au parent de savoir faire preuve de fermeté sans rejet, de poser une limite tout en restant bienveillant et à l'écoute…
« Le pouvoir des trois seaux » est une méthode de gestion des conflits et difficultés éducatives ne se payant pas de théorie (type Spock ou Dolto, bien que très influencée par ces derniers) et restant toujours dans une perspective pratique avec des exemples parfaitement concrets. Exemple : « Comment réagir quand votre enfant vous frappe ou vous mord ? Vous ne parvenez pas à arrêtez le geste. Eloignez-vous en verbalisant votre douleur. Il continue de frapper ou mordre. Rappelez les alternatives. (Si tu es en colère, tu peux me le dire ainsi : « Maman, je suis très fâché… » Il continue de frapper ou mordre. Mettez-vous à l'écart. » Beaucoup d'illustrations, de petits dessins, de schémas, des outils de travail, un test, des questionnaires, des fiches. On sent que le problème a été étudié avec soin et sous tous ces aspects. Les auteures nous promettent « moins de conflits et une relation parent-enfant épanouie ». Acceptons-en l'augure en nous rappelant que tout est question de limites et qu'il est normal qu'un enfant cherche en permanence à les repousser pour se construire et s'affirmer. C'est à l'adulte d'être ferme et conséquent dans ses attitudes. Si notre attention est avec raison attirée sur l'abus des produits sucrés, le manque de sommeil et d'exercice de l'enfant, pas un mot sur les conséquences catastrophiques de l'abus d'écrans dès le plus jeune âge, de l'absence d'image masculine (on a l'impression d'un livre écrit par des femmes, pour des femmes en situation mono-parentale ou de famille recomposée) ou de situations déstabilisantes (divorce, abandon, attitudes éducatives divergentes de deux parents séparés, etc.) Mais cela pourrait donner lieu à un autre ouvrage.
3,5/5
08:59 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)
14/09/2025
Le courrier du Tsar (Charles Lucieto)
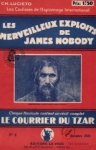 À Tsarskoïé-Sela, l'agent secret James Nobody rencontre le général Soyekoff, grand responsable de la sécurité de la famille impériale. Il se désole de voir les émeutes se succéder et le sang couler dans les rues. De plus, les conjurations visant à renverser le Tsar se multiplient. Certaines viennent même de l'entourage du monarque. Il en est à ne plus pouvoir faire confiance à personne. Il pense que seul Nobody pourrait sauver la situation. En effet, même Bieletzkoff, un des chefs de l'Okhrana (police secrète) serait compromis. Sans oublier le fameux Raspoutine dont personne ne sait vraiment pour qui il agit. On dit qu'il commanderait les forces obscures, alors que la cour est déjà partagée ou plutôt déchirée entre les slavophiles et les germanophiles. Au milieu de toutes ces intrigues, le tsar Nicolas se sent bien seul. Il n'a même pas de parti pour le soutenir. De plus, l'impératrice Alexandra n'est pas bien acceptée à cause de ses origines. Beaucoup la surnomment « Niemka », l'Allemande, la Boche… Pour pouvoir mener à bien son enquête qui consistera à empêcher un nouvel attentat, James Nobody obtient de Soyekoff d'être intégré aux « Courriers du Tsar » ainsi aura-t-il les coudées franches pour circuler à sa guise dans le palais.
À Tsarskoïé-Sela, l'agent secret James Nobody rencontre le général Soyekoff, grand responsable de la sécurité de la famille impériale. Il se désole de voir les émeutes se succéder et le sang couler dans les rues. De plus, les conjurations visant à renverser le Tsar se multiplient. Certaines viennent même de l'entourage du monarque. Il en est à ne plus pouvoir faire confiance à personne. Il pense que seul Nobody pourrait sauver la situation. En effet, même Bieletzkoff, un des chefs de l'Okhrana (police secrète) serait compromis. Sans oublier le fameux Raspoutine dont personne ne sait vraiment pour qui il agit. On dit qu'il commanderait les forces obscures, alors que la cour est déjà partagée ou plutôt déchirée entre les slavophiles et les germanophiles. Au milieu de toutes ces intrigues, le tsar Nicolas se sent bien seul. Il n'a même pas de parti pour le soutenir. De plus, l'impératrice Alexandra n'est pas bien acceptée à cause de ses origines. Beaucoup la surnomment « Niemka », l'Allemande, la Boche… Pour pouvoir mener à bien son enquête qui consistera à empêcher un nouvel attentat, James Nobody obtient de Soyekoff d'être intégré aux « Courriers du Tsar » ainsi aura-t-il les coudées franches pour circuler à sa guise dans le palais.
« Le courrier du Tsar » est un roman d'espionnage tout à fait classique. C'est le deuxième titre de la série « Les merveilleux exploits de James Nobody ». C'est une histoire complète qui se lit facilement tant le style est fluide et tant le rythme de narration est soutenu. Comme dans les autres titres, l'espion anglais est d'une totale efficacité. C'est un observateur digne de Sherlock Holmes. Aucune énigme ne lui résiste. Les rebondissements et les surprises ne manquent pas. En plus du plaisir de lecture d'une aventure divertissante, le lecteur aura droit à une plongée dans le monde de la cour impériale qui vit ses derniers jours, se sent condamné et est prêt à toutes les compromissions en particulier avec l'Allemagne. Le portrait de Raspoutine n'est pas piqué des hannetons. Le personnage est dépeint comme halluciné, alcoolique et obsédé sexuel. Intéressant.
4/5
09:14 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)