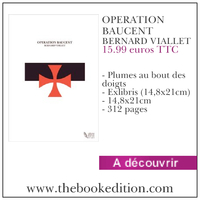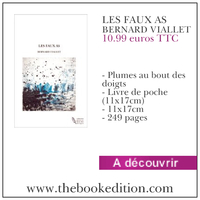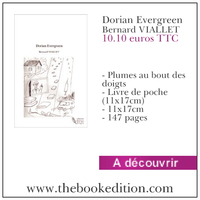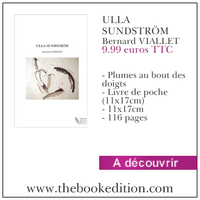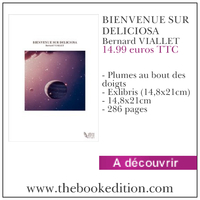18/02/2026
Le secret du Fellah (Charles Lucieto)
 Quelques années après la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne s'apprête à accorder une indépendance partielle à l'Egypte. Les négociations entre Mohamed Mahmoud Pacha et les plénipotentiaires anglais s'annoncent difficiles. Ceux-ci veulent conserver le possession du Canal de Suez ainsi que celle de toutes leurs bases militaires. Le maréchal Lord Addendy craint que tout cela ne tourne au marché de dupes. Il charge James Nobody, le célèbre agent secret, de sonder les intentions véritables du Pacha et par la même occasion de retrouver la trace d'une Miss Arabella Folstromp disparue mystérieusement. Il redoute qu'elle n'ait été la victime du « Coupeur de têtes », un terroriste insaisissable, qui a déjà assassiné pas moins de dix huit personnes qui toutes avaient tenté en vain de le capturer. Double tâche bien délicate pour Nobody…
Quelques années après la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne s'apprête à accorder une indépendance partielle à l'Egypte. Les négociations entre Mohamed Mahmoud Pacha et les plénipotentiaires anglais s'annoncent difficiles. Ceux-ci veulent conserver le possession du Canal de Suez ainsi que celle de toutes leurs bases militaires. Le maréchal Lord Addendy craint que tout cela ne tourne au marché de dupes. Il charge James Nobody, le célèbre agent secret, de sonder les intentions véritables du Pacha et par la même occasion de retrouver la trace d'une Miss Arabella Folstromp disparue mystérieusement. Il redoute qu'elle n'ait été la victime du « Coupeur de têtes », un terroriste insaisissable, qui a déjà assassiné pas moins de dix huit personnes qui toutes avaient tenté en vain de le capturer. Double tâche bien délicate pour Nobody…
« Le secret du Fellah » est le douzième et ultime épisode de la série des « Merveilleux exploits de James Nobody ». Le format est toujours court, rythmé et ramassé. L'action est bien menée avec les habituelles surprises et rebondissements qui tiennent toujours le lecteur en haleine. Il remarquera d'ailleurs qu'une fois encore la taupe, le traitre et le criminel ne sont pas ceux que l'on pourrait imaginer au début. Et dans cet épisode égyptien, tout comme dans les épisodes en Inde, les partisans de l'indépendance et de la souveraineté des peuples sous le joug anglais sont toujours présentés au bout du compte comme valeureux et loyaux alors que les méchants sortent toujours du camp colonial. Ouvrage intéressant surtout pour son côté historique. Il montre en effet un peu les coulisses de cette fin mouvementée de protectorat. Le joug turc a été remplacé par le joug anglais. Les Egyptiens se sont comportés loyalement pendant la guerre en se battant au côté des troupes anglaises. En retour, ils espèrent obtenir leur indépendance et récupérer le Soudan qu'ils considèrent comme faisant partie de leur pays depuis la nuit des temps. Mais la Grande-Bretagne ne l'entend pas de cette oreille. D'où la période troublée en question.
4,5/5
09:01 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)
13/02/2026
Un drame au quartier général du Kaiser (Charles Lucieto)
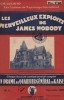 À Spa (Belgique) en octobre 1918, le comte Von Opern, chef des services secrets allemands, est au comble de la fureur quand il découvre sur son bureau une lettre qui a été déposée par quelqu'un alors que plusieurs gardes avaient eu ordre d'en interdire l'accès à quiconque. Il soupçonne même l'agent James Nobody d'avoir accompli ce forfait. Et c'est l'abattement complet lorsqu'il lit la lettre signée du paraphe du grand agent secret anglais. Et ce qu'il lit est encore bien pire que le reste. Nobody lui annonce qu'il a été contaminé par un agent chimique nouveau qui va rapidement transformer ses lésions bénignes en cancers et lui occasionner une mort horrible accompagnée d'atroces souffrances. Opern convoque son médecin personnel qui a le regret de lui dire qu'il ne va rien pouvoir pour lui. Aucun remède, aucun antidote, aucun contrepoison ne peut le sauver…
À Spa (Belgique) en octobre 1918, le comte Von Opern, chef des services secrets allemands, est au comble de la fureur quand il découvre sur son bureau une lettre qui a été déposée par quelqu'un alors que plusieurs gardes avaient eu ordre d'en interdire l'accès à quiconque. Il soupçonne même l'agent James Nobody d'avoir accompli ce forfait. Et c'est l'abattement complet lorsqu'il lit la lettre signée du paraphe du grand agent secret anglais. Et ce qu'il lit est encore bien pire que le reste. Nobody lui annonce qu'il a été contaminé par un agent chimique nouveau qui va rapidement transformer ses lésions bénignes en cancers et lui occasionner une mort horrible accompagnée d'atroces souffrances. Opern convoque son médecin personnel qui a le regret de lui dire qu'il ne va rien pouvoir pour lui. Aucun remède, aucun antidote, aucun contrepoison ne peut le sauver…
« Un drame au quartier général du Kaiser » est un court roman d'espionnage datant de 1929. C'est le onzième épisode de la série des « Merveilleux exploits de James Nobody ». Il est un peu différent des autres dans la mesure où même si le lecteur y trouvera encore les facéties, les retournements de situation et les tours pendables du héros avec ses changements d'identité et d'apparences habituelles, il sera nettement plus intéressé par le contexte historique particulièrement travaillé. Nous sommes dans les toutes dernières semaines et même journées de la Première Guerre mondiale. Rien ne va plus pour les Allemands. À Berlin et dans les grandes villes, la révolution bolchevique est en marche. Les drapeaux rouges sont sortis, les émeutiers sont partout. Les symboles du Reich sont abattus. Certains s'en prennent même à des gradés isolés. Des comités d'ouvriers et d'artisans, sortes de soviets se créent partout. Et pendant ce temps, le Kaiser Guillaume II tergiverse et renâcle à abdiquer. Mais Nobody va y aider, ce qui bien sûr est pure fiction. La description de la scène, celle du personnage présenté comme la pire crapule que l'agent ait eu à rencontrer, tout comme les dessous de la signature de l'armistice dans le wagon de la clairière de Rethondes (forêt de Compiègne) ne peuvent qu'intéresser l'amateur d'Histoire…
4,5/5
08:01 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)
09/02/2026
Les Vengeurs d'Isis (Charles Lucieto)
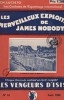 À Thèbes, en Egypte vient d'être découvert un ensemble de temples et de nécropoles dans lesquels on a trouvé un trésor inestimable attribué à Sésostris II et enfoui depuis des siècles sous les limons et les sables du Nil. Mais voilà que ce trésor placé en haute sécurité et sous surveillance permanente est volé d'une manière tout à fait stupéfiante. Il disparaît sans laisser d'autres traces que les cadavres des trois détectives chargés de sa protection. Bizarrement, l'autopsie n'a pas pu fournir une explication acceptable de leur décès. En désespoir de cause, Monsieur Roger de la Garenne, directeur français du musée de recherches archéologiques, charge l'agent James Nobody de la délicate mission d'élucider ce mystère et surtout de retrouver ce trésor disparu sans laisser de traces…
À Thèbes, en Egypte vient d'être découvert un ensemble de temples et de nécropoles dans lesquels on a trouvé un trésor inestimable attribué à Sésostris II et enfoui depuis des siècles sous les limons et les sables du Nil. Mais voilà que ce trésor placé en haute sécurité et sous surveillance permanente est volé d'une manière tout à fait stupéfiante. Il disparaît sans laisser d'autres traces que les cadavres des trois détectives chargés de sa protection. Bizarrement, l'autopsie n'a pas pu fournir une explication acceptable de leur décès. En désespoir de cause, Monsieur Roger de la Garenne, directeur français du musée de recherches archéologiques, charge l'agent James Nobody de la délicate mission d'élucider ce mystère et surtout de retrouver ce trésor disparu sans laisser de traces…
« Les Vengeurs d'Isis » est le dixième tome des « Merveilleux exploits de James Nobody ». La série complète en comporte douze. Elle est sous-titrée « les coulisses de l'espionnage international ». James Nobody est en quelque sorte l'ancêtre des James Bond et autres OSS117. Cette fois encore, sa perspicacité et ses qualités hors normes ne manquent pas à l'appel. L'intrigue ne manque ni de rebondissements ni de surprises. Les Vengeurs d'Isis se retrouvent coiffés sur le poteau par de terribles agents secrets de Moscou avec la traitrise d'un personnage important de la nomenklatura britannique. L'ensemble se lit rapidement et avec un certain plaisir. Bien entendu, on n'écrit plus de cette façon de nos jours. Mais il est quand même rafraîchissant de retrouver de belles valeurs comme le courage, la fidélité et l'entraide (cette fois, les jeunes adjoints de Nobody lui sauvent la mise in extremis). Tout finit pour le mieux. Les méchants sont punis et les gentils récompensés. Que demander de plus ?
4/5
08:20 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)
06/02/2026
La chaussée des géants (Pierre Benoit)
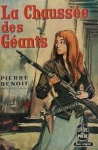 En 1916, blessé de la Guerre des Tranchées, Gérard une fois remis sur pieds est affecté comme secrétaire au ministère de la guerre à Paris. Il s'adonne à des recherches linguistiques sur le mingrélien et devient ami avec Vincent Laboulbène, fils d'un célèbre constructeur automobile de l'époque. Celui-ci lui fait rencontrer un certain Térence, homme un peu mystérieux, revenu lui aussi du front et qui semble se cacher. En effet, il a combattu dans les troupes irlandaises aux côtés des Français. Mais maintenant, il estime qu'il est grand temps de quitter la lutte contre les Allemands pour se retourner contre les Anglais qui occupent injustement l'Irlande depuis tant d'années. Terence s'est intéressé à Gérard car il l'a confondu avec le Professeur Gérard du Collège de France, grand spécialiste des langues gaéliques. Gérard n'ose pas démentir et le voilà embarqué vers la verte Erin où il devra jouer le rôle d'observateur international en compagnie de quelques autres scientifiques venus de plusieurs pays, Suisse, Etats-Unis, Espagne et même Japon…
En 1916, blessé de la Guerre des Tranchées, Gérard une fois remis sur pieds est affecté comme secrétaire au ministère de la guerre à Paris. Il s'adonne à des recherches linguistiques sur le mingrélien et devient ami avec Vincent Laboulbène, fils d'un célèbre constructeur automobile de l'époque. Celui-ci lui fait rencontrer un certain Térence, homme un peu mystérieux, revenu lui aussi du front et qui semble se cacher. En effet, il a combattu dans les troupes irlandaises aux côtés des Français. Mais maintenant, il estime qu'il est grand temps de quitter la lutte contre les Allemands pour se retourner contre les Anglais qui occupent injustement l'Irlande depuis tant d'années. Terence s'est intéressé à Gérard car il l'a confondu avec le Professeur Gérard du Collège de France, grand spécialiste des langues gaéliques. Gérard n'ose pas démentir et le voilà embarqué vers la verte Erin où il devra jouer le rôle d'observateur international en compagnie de quelques autres scientifiques venus de plusieurs pays, Suisse, Etats-Unis, Espagne et même Japon…
« La chaussée des géants » est un roman à contexte historique fort bien écrit et fort agréable à lire, même s'il date de 1922. L'histoire bien construite démarre un peu comme un roman sentimental et se poursuit avec des rebondissements et des quiproquos. Gérard n'est pas le vrai, mais il n'est pas le seul ! La clé de l'intrigue et son fil rouge est une légende gaélique qui prédit la fin de la domination anglaise et la libération de l'Irlande. Elle serait liée à la naissance de l'héroïne, la belle Antiope d'Antrim dont Gérard est plus ou moins amoureux depuis l'enfance et dont le père, aristocrate handicapé, est le chef secret de la résistance. L'action est un peu lente à démarrer, mais le lecteur s'attache très vite aux personnages d'autant plus qu'il devine que tous sont condamnés à finir tués ou blessés dans les affrontements à venir, voire, pendus, fusillés ou déportés s'ils sont capturés. Le dernier quart de l'ouvrage est passionnant et mérite à lui seul le détour. Il décrit les combats désespérés à Dublin et dans toute l'Irlande qui s'achevèrent dans un bain de sang, l'armée britannique n'hésitant pas à tirer au canon sur la foule ! Et en prime, le lecteur aura droit à une fin surprenante avec un dernier quiproquo sous forme d'usurpation d'identité pour la bonne cause bien sûr. Pierre Benoit est un peu oublié de nos jours et c'est bien dommage.
4,5/5
09:19 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)
03/02/2026
Griffu (Manchette & Tardi)
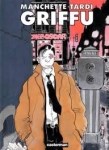 Une certaine Luce Minetta demande à Griffu qui n'est que conseiller juridique de l'aider à aller récupérer des dossiers importants. Mais au moment où celui-ci arrive à mettre la main dessus, elle les récupère et file avec alors que Griffu se retrouve piégé dans la maison dont il a forcé la porte. Trois marlous lui tombent dessus. Il parvient à s'en débarrasser à coups de poings et rentre chez lui un peu amoché et le visage agrémenté d'un magnifique œil au beurre noir. Pour en avoir le cœur net, il passe au domicile de Luce où il ne trouve qu'Evangéline sa co-locataire étudiante avec qui il sympathise immédiatement. Ils sont au lit quand les trois voyous du début les surprennent en pleine action. Ceux-ci se trouvent également sur la piste de Luce et veulent aussi récupérer les dossiers en question. Ils offrent même de verser de l'argent à Griffu s'il parvient à mettre la main sur la fille et sur les papiers avant eux…
Une certaine Luce Minetta demande à Griffu qui n'est que conseiller juridique de l'aider à aller récupérer des dossiers importants. Mais au moment où celui-ci arrive à mettre la main dessus, elle les récupère et file avec alors que Griffu se retrouve piégé dans la maison dont il a forcé la porte. Trois marlous lui tombent dessus. Il parvient à s'en débarrasser à coups de poings et rentre chez lui un peu amoché et le visage agrémenté d'un magnifique œil au beurre noir. Pour en avoir le cœur net, il passe au domicile de Luce où il ne trouve qu'Evangéline sa co-locataire étudiante avec qui il sympathise immédiatement. Ils sont au lit quand les trois voyous du début les surprennent en pleine action. Ceux-ci se trouvent également sur la piste de Luce et veulent aussi récupérer les dossiers en question. Ils offrent même de verser de l'argent à Griffu s'il parvient à mettre la main sur la fille et sur les papiers avant eux…
« Griffu » se présente comme une bande dessinée illustrant une histoire bien dans le style sombre et désabusé de Jean-Patrick Manchette. L'histoire est un brin simpliste avec son contexte politico-social assez classique. Griffu se retrouve dans une sombre affaire de scandale immobilier comme il y en eut tant dans les années 70/80. Il y avait pas mal de fric à se faire dans la réhabilitation de certains quartiers complètement délabrés de la capitale et de ses alentours. Le graphisme de Tardi est original, sombre et grisâtre à souhait. Il rend bien l'atmosphère de certains coins de banlieue parisienne déjà à la dérive. Le passage du purement littéraire à l'univers plus visuel de la BD ne nous semble pas apporter grand-chose à l'esprit et à l'ambiance des œuvres de Manchette. Il en souligne juste le côté simpliste, la violence presque gratuite et les idées reçues et déjà datées. Les personnages sont encore plus caricaturaux que dans les romans. C'est noir et manichéen. Et comme la BD fait ressortir encore plus les faiblesses du propos, cela semble sans grand intérêt pour nous au bout du compte.
3/5
08:58 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)
31/01/2026
La princesse du sang (Jean-Patrick Manchette)
 Ivory, jeune photographe animalière, a décidé de camper dans la Sierra Maestra, partie désertique de Cuba. Elle compte y séjourner le plus longtemps possible. Elle passe son temps à photographier animaux et plantes jusqu'au jour où elle rencontre un homme à demi-nu, accompagné d'une gamine de treize ans plutôt crasseuse qui eux aussi survivent dans ce milieu hostile. Ivory découvre que celui qu'elle prenait pour un autochtone s'appelle en réalité Victor Maurer et que la petite Negra n'est pas sa fille, mais une enfant qu'il a adoptée… Un milliardaire juif proche de la mafia, Samuel Farakhan, ami et protecteur d'Ivory, apprend qu'elle est en danger. Il décide de partir la rejoindre… En effet, des barbouzes et autres agents secrets se sont lancés sur la trace des « campeurs » de la sierra cubaine. La poudre va parler. Les deux filles vont prendre la poudre d'escampette et tenter de sauver leur peau…
Ivory, jeune photographe animalière, a décidé de camper dans la Sierra Maestra, partie désertique de Cuba. Elle compte y séjourner le plus longtemps possible. Elle passe son temps à photographier animaux et plantes jusqu'au jour où elle rencontre un homme à demi-nu, accompagné d'une gamine de treize ans plutôt crasseuse qui eux aussi survivent dans ce milieu hostile. Ivory découvre que celui qu'elle prenait pour un autochtone s'appelle en réalité Victor Maurer et que la petite Negra n'est pas sa fille, mais une enfant qu'il a adoptée… Un milliardaire juif proche de la mafia, Samuel Farakhan, ami et protecteur d'Ivory, apprend qu'elle est en danger. Il décide de partir la rejoindre… En effet, des barbouzes et autres agents secrets se sont lancés sur la trace des « campeurs » de la sierra cubaine. La poudre va parler. Les deux filles vont prendre la poudre d'escampette et tenter de sauver leur peau…
« La princesse du sang » est un roman inachevé de Manchette, auteur disparu prématurément. Ayant obtenu un vif succès avec ses précédents ouvrages, Manchette souhaitait se renouveler complètement autant au niveau du fond que de la forme. Il envisageait de produire des romans plus politiques, sous forme de fresques ou de sagas s'étendant sur plusieurs décennies avec pour arrière-plan de grands évènements mondiaux comme la révolte de Budapest écrasée par les chars russes ou la guerre d'Algérie avec des personnages récurrents que l'on suivrait sur de nombreuses années. Au niveau du style, il cherchait à en finir avec le côté percutant, décharné, « close-to-the-bone » de ses débuts. Il se voulait plus descriptif, quasi balzacien. Malheureusement, ce texte sans doute à retravailler est marqué par une grande lourdeur. Le descriptif qui se veut hyper méticuleux plombe tout. Le pauvre lecteur a droit à la température du jour, au chemisage des armes, au nom des marques et à mille détails qui ne font que plomber le rythme de la narration. Il ne se passe pas grand-chose dans cette histoire qui n'a ni queue ni tête et aucune fin. Le bouquin finit même par tomber des mains et il faut se faire violence pour aller jusqu'au bout, en se demandant même s'il n'aurait pas mieux valu laisser ce « brouillon » dormir pour toujours dans un fond de tiroir… À fuir !
2/5
09:01 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)
28/01/2026
Le chouan du Tyrol (Jean Sévillia)
 En 1809, après plusieurs défaites militaires, le Tyrol a été détaché de l'Autriche et placé sous la coupe de la Bavière alors alliée de Napoléon. Il se retrouve écrasé d'impôts, avec toutes ses anciennes institutions anéanties, son clergé persécuté (fermeture des couvents et des monastères, saisie des biens de l'Eglise catholique, prêtres exilés ou jureurs) et mise en place de la conscription obligatoire inconnue jusque là. Depuis fort longtemps, sous l'égide des Habsbourg, le peuple pouvait disposer d'armes pour se défendre, il avait aussi le droit de se constituer en milices paysannes chargées de défendre le territoire mais sans jamais devoir se retrouver engagé à l'étranger. Tout est donc réuni pour une insurrection de type vendéen. Un homme prend la tête du mouvement, un simple aubergiste, Andréas Hofer qui réussit à rassembler suffisamment d'hommes armés pour faire subir plusieurs revers aux soldats bavarois et français chargés de la répression. Hofer se retrouve un temps régent du Tyrol. Il siège même au palais d'Innsbrück et tente d'organiser le pays. Mais Napoléon qui ne supporte pas qu'une poignée de montagnards en culotte de peau résiste aussi vaillamment et le tienne aussi longtemps en échec va mettre les moyens pour écraser dans le sang cette révolte paysanne…
En 1809, après plusieurs défaites militaires, le Tyrol a été détaché de l'Autriche et placé sous la coupe de la Bavière alors alliée de Napoléon. Il se retrouve écrasé d'impôts, avec toutes ses anciennes institutions anéanties, son clergé persécuté (fermeture des couvents et des monastères, saisie des biens de l'Eglise catholique, prêtres exilés ou jureurs) et mise en place de la conscription obligatoire inconnue jusque là. Depuis fort longtemps, sous l'égide des Habsbourg, le peuple pouvait disposer d'armes pour se défendre, il avait aussi le droit de se constituer en milices paysannes chargées de défendre le territoire mais sans jamais devoir se retrouver engagé à l'étranger. Tout est donc réuni pour une insurrection de type vendéen. Un homme prend la tête du mouvement, un simple aubergiste, Andréas Hofer qui réussit à rassembler suffisamment d'hommes armés pour faire subir plusieurs revers aux soldats bavarois et français chargés de la répression. Hofer se retrouve un temps régent du Tyrol. Il siège même au palais d'Innsbrück et tente d'organiser le pays. Mais Napoléon qui ne supporte pas qu'une poignée de montagnards en culotte de peau résiste aussi vaillamment et le tienne aussi longtemps en échec va mettre les moyens pour écraser dans le sang cette révolte paysanne…
« Le chouan du Tyrol » est un essai historique très intéressant autour de la personnalité d'un héros de l'indépendance du peuple autrichien. Sévillia consacre plus du tiers de son ouvrage à analyser la situation militaire et politique du moment. Il montre ensuite les causes de l'affrontement qui sont les mêmes que celles qui ensanglantèrent la Vendée, la Bretagne, l'Anjou et certains territoires du Midi pendant la Terreur. Il précise que dans le cas français, il s'agissait plus de guerre civile, des Français se battant entre eux, alors que dans le cas du Tyrol, les Franco-Bavarois étaient des envahisseurs et des usurpateurs pour les habitants du Tyrol. Malheureusement pour Hofer, simple montagnard franc et honnête, il finit par se retrouver victime de la double trahison des Habsbourg qui signèrent la paix et l'abandonnèrent à son triste sort alors qu'ils auraient pu lui sauver la mise. Eternelle ingratitude des puissants vis à vis des petites gens… Ouvrage à lire pour découvrir ce pan peu connu et finalement peu reluisant de l'épopée napoléonienne qui se fit dans le sang et la souffrance, et dans le mépris total du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes…
4,5/5
08:45 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)
24/01/2026
Nouvelles Volume 2 (H.G. Wells)
 En Inde, une expédition d'exploration se solde par la mort de deux hommes. Un petit groupe se retrouve bloqué sur une plateforme rocheuse par des indigènes très hostiles. Pour aller chercher du secours, le chef a l'idée d'improviser une sorte de parachute à l'aide d'une toile de tente… Harringay, peintre de son état, a toutes les peines du monde à réaliser un portrait dont il soit satisfait. Il barbouille et jamais l'expression n'est la bonne. Jusqu'au moment où le tableau se met à lui parler… Un homme assez jeune doit dormir dans la chambre rouge d'un vieux manoir. Les gardiens le préviennent que l'endroit est hanté. L'homme s'y installe quand même en disant qu'il ne croit pas aux histoires de fantômes… M. Fison fait une étrange découverte sur une plage au pied d'une falaise. De gros céphalopodes, sortes de pieuvres géantes sont en train de dévorer tranquillement le cadavre d'un malheureux noyé… Monson veut construire une machine volante. Il commence par faire édifier tout un échafaudage constitué de poutres et de traverses métalliques, sorte de montagnes russes devant servir de catapulte à son engin. Et vient le jour tant redouté par Monson, celui du premier vol…
En Inde, une expédition d'exploration se solde par la mort de deux hommes. Un petit groupe se retrouve bloqué sur une plateforme rocheuse par des indigènes très hostiles. Pour aller chercher du secours, le chef a l'idée d'improviser une sorte de parachute à l'aide d'une toile de tente… Harringay, peintre de son état, a toutes les peines du monde à réaliser un portrait dont il soit satisfait. Il barbouille et jamais l'expression n'est la bonne. Jusqu'au moment où le tableau se met à lui parler… Un homme assez jeune doit dormir dans la chambre rouge d'un vieux manoir. Les gardiens le préviennent que l'endroit est hanté. L'homme s'y installe quand même en disant qu'il ne croit pas aux histoires de fantômes… M. Fison fait une étrange découverte sur une plage au pied d'une falaise. De gros céphalopodes, sortes de pieuvres géantes sont en train de dévorer tranquillement le cadavre d'un malheureux noyé… Monson veut construire une machine volante. Il commence par faire édifier tout un échafaudage constitué de poutres et de traverses métalliques, sorte de montagnes russes devant servir de catapulte à son engin. Et vient le jour tant redouté par Monson, celui du premier vol…
« Nouvelles volume 2 » est un recueil de 15 nouvelles du très grand H. G. Wells. Bien que datant du tout début de l'autre siècle, ces nouvelles semblent ne pas avoir pris une ride tant elles sont divertissantes et agréables à lire. Celles-ci sont d'ailleurs plus courtes, plus ramassées que celles du tome précédent. L'auteur y aborde une grande quantité de sujets et nombre de thèmes relevant du fantastique au quotidien, de l'onirique, de l'anticipation, de la fantaisie et de l'horreur (Wells pouvait être gore avant l'heure !). Le style est exceptionnel, toujours plein d'élégance et même d'humour. Tous les textes sont d'excellente qualité. Certaines histoires relèvent même du conte philosophique comme « L'homme qui pouvait accomplir des miracles » ou « L'histoire de feu M. Elvisham », ma préférée car la plus amusante. Le lecteur pourra aussi apprécier en lisant toutes ces histoires extraordinaires et extravagantes la richesse de l'imagination de l'auteur qui fut un précurseur très en avance sur son temps. Il ouvrit la voie à nombre d'écrivains qui s'inspirèrent de lui sans toujours arriver à son niveau. Il faut lire et relire H.G Wells !
4,5/5
08:47 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)
19/01/2026
Nouvelles Volume 1 (H.G. Wells)
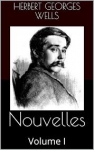 Une nouvelle étoile inconnue apparaît dans le ciel. Et voilà qu'elle tend à se rapprocher dangereusement de la Terre. La panique commence à s'installer dans tous les pays du monde. Le Grand Mathématicien prévoit des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des cyclones, des raz de marées et une hausse sans limite des températures… Un engin métallique en forme de sphère, sorte d'ancêtre du bathyscaphe, doit être descendu dans les profondeurs de l'océan. Tout le monde a des doutes sur la résistance des hublots à la pression de l'eau. Un volontaire, Elstead, s'y installe cependant. En sortira-t-il vivant ?… Monsieur Cave, antiquaire, demande cinq guinées à un clergyman désirant lui acheter un œuf de cristal, avant de se dédire, prétextant qu'un autre client aurait déjà réservé l'objet… Le professeur Gibberne a inventé un nouvel accélérateur, une mixture qui permettrait aux humains de vivre sur un rythme nettement plus rapide que l'habituel. L'ennui c'est que celui qui prendrait de cet élixir risquerait d'être adulte à 11 ans, d'âge mûr à 25 et sénile à 30. Il tente quand même l'expérience…
Une nouvelle étoile inconnue apparaît dans le ciel. Et voilà qu'elle tend à se rapprocher dangereusement de la Terre. La panique commence à s'installer dans tous les pays du monde. Le Grand Mathématicien prévoit des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des cyclones, des raz de marées et une hausse sans limite des températures… Un engin métallique en forme de sphère, sorte d'ancêtre du bathyscaphe, doit être descendu dans les profondeurs de l'océan. Tout le monde a des doutes sur la résistance des hublots à la pression de l'eau. Un volontaire, Elstead, s'y installe cependant. En sortira-t-il vivant ?… Monsieur Cave, antiquaire, demande cinq guinées à un clergyman désirant lui acheter un œuf de cristal, avant de se dédire, prétextant qu'un autre client aurait déjà réservé l'objet… Le professeur Gibberne a inventé un nouvel accélérateur, une mixture qui permettrait aux humains de vivre sur un rythme nettement plus rapide que l'habituel. L'ennui c'est que celui qui prendrait de cet élixir risquerait d'être adulte à 11 ans, d'âge mûr à 25 et sénile à 30. Il tente quand même l'expérience…
Ce premier recueil rassemble onze nouvelles publiées entre 1897 et 1901. En dépit de leur grand âge, ces textes impeccablement écrits sont toujours très agréables à lire. Le lecteur a même l'impression que le temps n'a pas eu d'emprise sur elles. Il découvre aussi à quel point H.G.Wells fut un précurseur dans de nombreux domaines. Au fil de toutes ces histoires passionnantes, il explore les voyages hors du corps (qu'on appellera plus tard EMI), la télépathie, les univers parallèles, les hallucinations causées par des drogues ou de l'auto-suggestion, l'onirisme, le spiritisme, l'ésotérisme et même le monde des elfes, des fées et des lutins dans la toute dernière et peut-être la plus charmante de cette compilation. À lire absolument ne serait-ce que pour se rendre compte du niveau exceptionnel de ce visionnaire à l'imagination débordante qui fit tant d'adeptes et de suiveurs pas tous forcément de son niveau d'ailleurs…
4,5/5
08:57 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)
14/01/2026
L'effroyable drame de Malhem (Charles Lucieto)
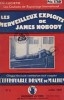 En 1918, à Saint-Omer, l'agent secret James Nobody se présente à l'état-major anglais. Tout le monde le croyait mort exécuté. Les Allemands l'avaient d'ailleurs annoncé officiellement. En réalité, c'était un agent français nommé Jean Rochereau avec qui il faisait équipe qui s'était sacrifié et qui avait été fusillé à sa place. La mission des deux agents étaient de s'emparer des résultats des expériences du Docteur Gustav Holrath du Kaiser Institut de Malhem. Ce dernier était en train de mettre au point une nouvelle arme chimique particulièrement dangereuse. La guerre mondiale n'était plus loin de sa fin. L'état-major allemand espérait encore remporter la victoire grâce à cette nouvelle arme, un composé ultra-dangereux de strychnine et de brucine qui aurait pu décimer les troupes alliées et même les populations civiles. Nobody parvient à se faire accepter dans le laboratoire secret du Reich à titre de chimiste et même à gagner l'amitié de Karl Blumenthal, souffre-douleurs de ses autres scientifiques. Nobody parviendra-t-il à organiser un sabotage et à voler la formule avec l'aide de Rochereau pour empêcher que le conflit mondial ne tourne en faveur du Reich ?
En 1918, à Saint-Omer, l'agent secret James Nobody se présente à l'état-major anglais. Tout le monde le croyait mort exécuté. Les Allemands l'avaient d'ailleurs annoncé officiellement. En réalité, c'était un agent français nommé Jean Rochereau avec qui il faisait équipe qui s'était sacrifié et qui avait été fusillé à sa place. La mission des deux agents étaient de s'emparer des résultats des expériences du Docteur Gustav Holrath du Kaiser Institut de Malhem. Ce dernier était en train de mettre au point une nouvelle arme chimique particulièrement dangereuse. La guerre mondiale n'était plus loin de sa fin. L'état-major allemand espérait encore remporter la victoire grâce à cette nouvelle arme, un composé ultra-dangereux de strychnine et de brucine qui aurait pu décimer les troupes alliées et même les populations civiles. Nobody parvient à se faire accepter dans le laboratoire secret du Reich à titre de chimiste et même à gagner l'amitié de Karl Blumenthal, souffre-douleurs de ses autres scientifiques. Nobody parviendra-t-il à organiser un sabotage et à voler la formule avec l'aide de Rochereau pour empêcher que le conflit mondial ne tourne en faveur du Reich ?
« L'effroyable drame de Malhem » est le neuvième tome des « Merveilleux exploits de James Nobody », série d'aventures et d'espionnage (sous-titrée d'ailleurs « Les coulisses de l'espionnage international ») parue en juin 1929. L'histoire est enlevée, agréable à lire et divertissante. Même si Lucieto fut un authentique agent secret de son époque et même s'il se base sur certains faits ou circonstances réelles, il prend pas mal de privautés avec la réalité historique. Il fait œuvre de romancier, multiplie les rebondissements, parfois à la limite du vraisemblable pour tenir en haleine son public. Son héros est un James Bond ou un OSS 117 avant l'heure. Il est paré de toutes les vertus, fort comme un lion, rusé comme un renard, plein d'élégance, de charme et de séduction. À l'époque, le public était conquis et en redemandait. La série eut un très grand succès. Elle peut encore se lire aujourd'hui pour le plaisir et même à titre de document.
4/5
08:32 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)