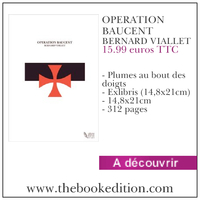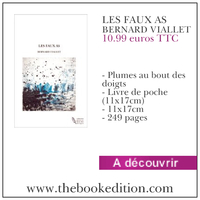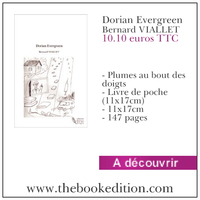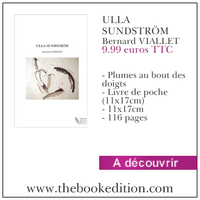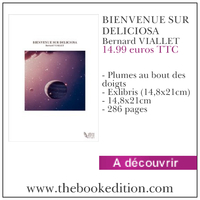03/07/2024
Lettre aux autruches et aux tubes digestifs (Nicolas Vidal)
 Cette très courte lettre d'une quarantaine de pages est adressée aux millions de Français qui préfèrent s'amuser, consommer, regarder la télé et/ou Netflix, qui ne s'informent pas, qui ne votent pas, qui ne militent pas. À toutes ces autruches qui mettent leur tête dans le sable, à tous ces tubes digestifs qui gobent tout et le répètent, vu que ça été "dit à la télé", l'alerteur un brin passionné Nicolas Vidal leur rappelle que c'est de leur faute si le pays va si mal, s'il est tombé si bas, si la démocratie déjà chancelante n'est plus qu'un faux semblant sans consistance. Depuis des années, une certaine élite a profité de cette apathie populaire pour trahir le pays de toutes les façons possibles. Depuis des décennies, elle n'a fait que se servir au lieu de servir. Et les résultats catastrophiques sont là. Il serait donc grand temps d'assister à un sursaut de citoyenneté, à une prise de conscience de nombre de ces braves consommateurs…
Cette très courte lettre d'une quarantaine de pages est adressée aux millions de Français qui préfèrent s'amuser, consommer, regarder la télé et/ou Netflix, qui ne s'informent pas, qui ne votent pas, qui ne militent pas. À toutes ces autruches qui mettent leur tête dans le sable, à tous ces tubes digestifs qui gobent tout et le répètent, vu que ça été "dit à la télé", l'alerteur un brin passionné Nicolas Vidal leur rappelle que c'est de leur faute si le pays va si mal, s'il est tombé si bas, si la démocratie déjà chancelante n'est plus qu'un faux semblant sans consistance. Depuis des années, une certaine élite a profité de cette apathie populaire pour trahir le pays de toutes les façons possibles. Depuis des décennies, elle n'a fait que se servir au lieu de servir. Et les résultats catastrophiques sont là. Il serait donc grand temps d'assister à un sursaut de citoyenneté, à une prise de conscience de nombre de ces braves consommateurs…
"Lettre aux autruches et aux tubes digestifs" se présente comme le "coup de gueule" d'un honnête citoyen déçu de l'attitude de certains de ses semblables. Ce n'est en aucun cas un pamphlet. Pas de caricature, pas d'outrance, pas d'invective chez Vidal, juste un état des lieux objectif, une description du champ de ruine qu'est devenue notre pays. Tout y passe depuis la décadence de l’Éducation Nationale, à l'abrutissement de la jeunesse avec les écrans, jeux vidéos et réseaux sociaux en passant par la révolte des "Gilets Jaunes", la crise sanitaire avec toutes ses atteintes aux libertés, les fleurons de notre industrie bradés, etc. Un livre salutaire et à conseiller à tous ceux qui n'ont pas encore saisi l'ampleur de l'enjeu. Un seul petit reproche: Vidal cite dans son texte quelques auteurs comme Brighelli, Desmurget, Vaguerlant et autres, mais ne propose pas de bibliographie en fin d'ouvrage. Cela aurait permis de mieux approfondir certains sujets et même d'étayer son propos.
4,5/5
08:38 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)
28/06/2024
Psychologie de la manipulation et de la soumission (Nicolas Guégen)
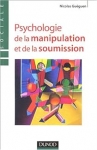 Jusqu’où sa tendance naturelle à l’obéissance peut-elle amener l’être humain ? Comment expliquer les exactions commises en temps de guerre par des soldats par ailleurs bons fils, bons pères de familles et maris doux et prévenants ? Y a-t-il une sauvagerie, une perversion latente que les circonstances, les rapports sociaux ou certaines manipulations feraient apparaître ? Peut-on être contraint à la violence par simple principe d’obéissance, par soumission à l’autorité ? Dans les expériences de Milgam qui consistaient à envoyer des décharges électriques (virtuelles) à un élève donnant de mauvaises réponses, tous les sujets sont allés jusqu’à 285 volts, 12,5% se sont arrêtés à 300 volts, 20% entre 315 et 360 volts et 65% ont poursuivi jusqu’au bout, soit de 435 à 450 volts ! Cela donne une idée de la puissance de suggestion représentée par une simple blouse blanche dans un banal exercice universitaire. Diverses études ont montré que selon l’aspect de l’interlocuteur, selon sa présentation vestimentaire ou son statut social, il était plus ou moins aisé de se soumettre à son autorité. Ainsi obéira-t-on plus facilement à un personnage en uniforme, à un bourgeois en costume cravate, à un médecin en blouse blanche qu’à un clochard en haillons.
Jusqu’où sa tendance naturelle à l’obéissance peut-elle amener l’être humain ? Comment expliquer les exactions commises en temps de guerre par des soldats par ailleurs bons fils, bons pères de familles et maris doux et prévenants ? Y a-t-il une sauvagerie, une perversion latente que les circonstances, les rapports sociaux ou certaines manipulations feraient apparaître ? Peut-on être contraint à la violence par simple principe d’obéissance, par soumission à l’autorité ? Dans les expériences de Milgam qui consistaient à envoyer des décharges électriques (virtuelles) à un élève donnant de mauvaises réponses, tous les sujets sont allés jusqu’à 285 volts, 12,5% se sont arrêtés à 300 volts, 20% entre 315 et 360 volts et 65% ont poursuivi jusqu’au bout, soit de 435 à 450 volts ! Cela donne une idée de la puissance de suggestion représentée par une simple blouse blanche dans un banal exercice universitaire. Diverses études ont montré que selon l’aspect de l’interlocuteur, selon sa présentation vestimentaire ou son statut social, il était plus ou moins aisé de se soumettre à son autorité. Ainsi obéira-t-on plus facilement à un personnage en uniforme, à un bourgeois en costume cravate, à un médecin en blouse blanche qu’à un clochard en haillons.
« Psychologie de la manipulation et de la soumission » est un essai psychologique intéressant, détaillé, s’appuyant sur de très nombreux travaux et au bout du compte très universitaire. L’auteur s’évertue à analyser les causes de la soumission d’un individu à un autre. Il analyse longuement une manipulation qu’il baptise « Pied dans la porte » qui consiste à demander un petit effort à quelqu’un avant de lui en demander un plus grand. Ou l’effet « Porte dans le nez », exact contraire du précédent. Le manipulateur fait une demande exorbitante, bien sûr refusée, pour pouvoir en placer une plus acceptable. Et ça marche alors que la réussite est bien moindre sans ces deux manœuvres. Il aborde également, mais un peu trop brièvement, tout ce qui concerne la culpabilisation. Il prouve également l’extrême importance du non-dit, du geste (un simple toucher de la main ou du bras, même furtif, peut changer la donne), du regard (extrêmement important pour la confiance) et du sourire qui fait immédiatement entrer en empathie. Rien sur les manipulations par la peur. D’une lecture un peu laborieuse en raison de la multiplication des exemples et des études, cet ouvrage reste cantonné aux comportements sociaux, aux rapports individuels, aux petits gestes du quotidien (donner plus ou moins de pourboire, signer ou non une pétition, rendre un service ou non, etc.) Le lecteur restera sur sa faim sur les manipulations de masse, la propagande médiatique, les « psyops », les travaux des cabinets dits « de conseil », des instituts de sondages et autres narratifs soigneusement distillés par les différents pouvoirs pour manipuler et soumettre à une bien plus grande échelle.
3,5/5
08:29 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)
23/06/2024
Le quai de Wigan (George Orwell)
 Dans les années 30, à Wigan (Grande-Bretagne), tout comme dans les bassins houillers du Lancashire et du Yorkshire, une très importante partie de la classe ouvrière vit dans des conditions particulièrement déplorables. Chômage, pauvreté, crasse, manque d’hygiène. Se retrouvant plus ou moins par la force des choses en immersion, Orwell commence par décrire la vie dans une pension de famille tout à fait minable, tenue par un couple de marchands de sommeil assez odieux et faisant également profession de tripiers presque sans clients vu le manque de fraicheur des denrées en question. Ils offrent des conditions de logement indignes à de pauvres miséreux, chômeurs, trimardeurs, handicapés suite à un accident dans la mine ou autres placiers de journaux à la commission. Puis, il descend dans les mines, ce qui lui permet de proposer une description des conditions de travail dantesques des mineurs de l’époque, très comparable à celles décrites par Zola dans « Germinal ». Les salaires des mineurs leur permettent tout juste de survivre dans des logements sales, insalubres, où on peut s’entasser à 7 dans deux pièces, sans eau courante, ni sanitaires et avec les latrines dans la cour de derrière !
Dans les années 30, à Wigan (Grande-Bretagne), tout comme dans les bassins houillers du Lancashire et du Yorkshire, une très importante partie de la classe ouvrière vit dans des conditions particulièrement déplorables. Chômage, pauvreté, crasse, manque d’hygiène. Se retrouvant plus ou moins par la force des choses en immersion, Orwell commence par décrire la vie dans une pension de famille tout à fait minable, tenue par un couple de marchands de sommeil assez odieux et faisant également profession de tripiers presque sans clients vu le manque de fraicheur des denrées en question. Ils offrent des conditions de logement indignes à de pauvres miséreux, chômeurs, trimardeurs, handicapés suite à un accident dans la mine ou autres placiers de journaux à la commission. Puis, il descend dans les mines, ce qui lui permet de proposer une description des conditions de travail dantesques des mineurs de l’époque, très comparable à celles décrites par Zola dans « Germinal ». Les salaires des mineurs leur permettent tout juste de survivre dans des logements sales, insalubres, où on peut s’entasser à 7 dans deux pièces, sans eau courante, ni sanitaires et avec les latrines dans la cour de derrière !
« Le quai de Wigan » est un ouvrage un peu particulier dans l’œuvre du grand George Orwell. En effet, la première partie se présente comme un véritable reportage d’investigation sur une réalité sociale douloureuse à une époque où l’Empire britannique est encore, mais plus pour longtemps, à son apogée. C’est la partie la plus intéressante du livre aussi bien du point de vue historique que social. On n’est pas bien loin du monde de Dickens tant la misère des classes laborieuses est encore énorme. La seconde partie est complètement différente. C’est un essai sur le socialisme, le communisme et son opposition avec le fascisme qu’Orwell voit en pleine expansion. Il reconnaît ne pas faire partie lui-même de la classe sociale des prolétaires, mais plutôt de celle des classes moyennes pas très élevées, celles qui, comme lui, ont bénéficié d’une sorte de bonus de classe en allant travailler dans les colonies. Ils dominaient les autochtones et pouvaient même bénéficier de serviteurs, chose inaccessible en métropole. Orwell reconnaît s’être vite lassé de ce statut en Birmanie et avoir tout quitté sur un coup de tête, avant de rentrer au pays. Bien que nombre de considérations soient encore valables de nos jours (il imagine l’évolution des gens de gauche partant du communisme, virant au socialisme et finissant dans le boboisme actuel) beaucoup sont datées, voire obsolètes, en particulier tout ce qui relève de l’évolution du fascisme et autres idéologies totalitaires.
4/5
08:45 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)
18/06/2024
L'eau de mer, milieu organique (René Quinton)
 Notre organisme est composé au trois-quart d’éléments liquides. Tous les organismes animaux ont une origine aquatique du fait qu’ils tirent leur origine d’une cellule qui est nécessairement un élément aquatique. Une étude raisonnée des différents modes respiratoires montre que seul le mode trachéen est véritablement aérien. Les trois autres, le cellulaire, le tégumentaire et le branchial restent fondamentalement aquatiques. De même, des quatre principaux habitats des animaux (les eaux de mer ou d’eau douce, les milieux organiques (parasites), les terres, les vases, les sables et tous les lieux humides, seule la surface des terres elle-même peut être considérée comme vraiment aérienne. Et que l’on remonte jusqu’à l’embryon et aux premières cellules, on en revient toujours à un milieu originel aquatique, fort proche de celui de l’eau de mer. Pour étayer sa théorie, Quinton raconte d’ailleurs une expérience tentée sur des chiens. Même en leur injectant de grandes quantités d’eau de mer, ceux-ci ne sont nullement importunés. Ils seraient même en meilleure forme avant qu’après…
Notre organisme est composé au trois-quart d’éléments liquides. Tous les organismes animaux ont une origine aquatique du fait qu’ils tirent leur origine d’une cellule qui est nécessairement un élément aquatique. Une étude raisonnée des différents modes respiratoires montre que seul le mode trachéen est véritablement aérien. Les trois autres, le cellulaire, le tégumentaire et le branchial restent fondamentalement aquatiques. De même, des quatre principaux habitats des animaux (les eaux de mer ou d’eau douce, les milieux organiques (parasites), les terres, les vases, les sables et tous les lieux humides, seule la surface des terres elle-même peut être considérée comme vraiment aérienne. Et que l’on remonte jusqu’à l’embryon et aux premières cellules, on en revient toujours à un milieu originel aquatique, fort proche de celui de l’eau de mer. Pour étayer sa théorie, Quinton raconte d’ailleurs une expérience tentée sur des chiens. Même en leur injectant de grandes quantités d’eau de mer, ceux-ci ne sont nullement importunés. Ils seraient même en meilleure forme avant qu’après…
« L’eau de mer, milieu organique » est un essai scientifique de 520 pages édité au tout début de l’autre siècle (1904). C’est très technique, d’une lecture laborieuse, vu que l’auteur étudie une à une toutes les espèces animales sous cet angle très particulier. Nul doute que sa découverte aurait pu révolutionner nos approches de la santé et bouleverser la médecine, mais pour cela, il aurait fallu plus s’intéresser au terrain qu’aux microbes et autres virus. Cela dit, l’ouvrage très technique, sans doute trop pour notre comprenette un peu réduite, nous a vite tombé des mains. Heureusement qu’il existe d’autres livres de vulgarisation sur l’eau de mer d’abord plus facile.
3,5/5
08:57 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)
13/06/2024
Dictionnaire des emmerdeuses (Patrick Gofman)
 Ce dictionnaire est un catalogue « raisonné » (précise l’auteur) des vies plus ou moins remarquables de toutes sortes de femmes. On passe de Laure Adler à Clara Zetkin, de la première représentante du beau sexe, Eve et son fruit défendu à l’une des dernières en date à la une des tabloïds, Paris Hilton, célèbre non pour son intelligence ou ses engagements sociaux ou politiques, mais pour ses frasques et caprices de fille gâtée de milliardaire dans l’hôtellerie, en passant par Eva Joly, Louise Michel, Françoise Sagan, Lady Di, Caroline Rousseau, Messaline et de nombreuses autres. En fait, le lecteur a l’impression d’un vaste fourre-tout de 681 pages où se côtoient illustres inconnues et authentiques célébrités, simples auditrices de la célèbre Macha et femmes politiques importantes comme Madeleine Albright ou Hillary Clinton ou célébrités de périodes plus reculées comme Olympe de Gouges ou Frédégonde…
Ce dictionnaire est un catalogue « raisonné » (précise l’auteur) des vies plus ou moins remarquables de toutes sortes de femmes. On passe de Laure Adler à Clara Zetkin, de la première représentante du beau sexe, Eve et son fruit défendu à l’une des dernières en date à la une des tabloïds, Paris Hilton, célèbre non pour son intelligence ou ses engagements sociaux ou politiques, mais pour ses frasques et caprices de fille gâtée de milliardaire dans l’hôtellerie, en passant par Eva Joly, Louise Michel, Françoise Sagan, Lady Di, Caroline Rousseau, Messaline et de nombreuses autres. En fait, le lecteur a l’impression d’un vaste fourre-tout de 681 pages où se côtoient illustres inconnues et authentiques célébrités, simples auditrices de la célèbre Macha et femmes politiques importantes comme Madeleine Albright ou Hillary Clinton ou célébrités de périodes plus reculées comme Olympe de Gouges ou Frédégonde…
Cet ouvrage assez original présente chacune de ces femmes dans une assez courte notice retraçant brièvement sa vie, ses exploits ou ses turpitudes avec un certain humour et même parfois une certaine « vacherie » (« qui aime bien châtie bien »). Ainsi apprend-on que « sainte » Clotilde, épouse de Clovis et responsable de la conversion de ce chef un brin « barbare » n’était sans doute pas aussi « séraphique » que ce que raconte sa légende. Elle n’aurait pas manqué d’une certaine cruauté. On pourra regretter que l’auteur ait ajouté à son inventaire à la Prévert des êtres légendaires ou mythique (fée Morgane), des personnages de bande dessinée (la Castafiore), des biographies d’actrices porno (Linda Lovelace et Tracy Lord) et même des associations aux financements troubles comme « Ni putes, ni soumises ». Dans cet ouvrage finalement assez polémique (toutes ces femmes sont à classer dans les « emmerdeuses, emmerdantes ou emmerderesses », selon Paul Valéry et Georges Brassens), on apprend entre autres choses qu’il y a en France 14 millions de célibataires ou veufs, plus 4 millions d’individus en couples non co-habitants pour 27 millions d’actifs et que 80% des divorces sont demandés par les femmes. Ouvrage intéressant, agréable à lire pour son ton décalé et un brin désabusé, mais qui ne plaira sans doute pas à tout le monde…
4,5/5
08:47 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)
09/06/2024
Rentre avant la nuit (Lisa Jewell)
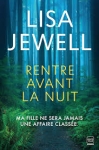 Dans la petite ville d'Upfield Common (Grande-Bretagne), un jeune couple, Tallulah et Zack (19 ans), s’offre une soirée de détente au pub du coin pendant que Kim, la mère de Tallulah, garde Noah, leur nourrisson. Assez tard dans la nuit, Kim reçoit un message lui annonçant qu’ils ne rentrent pas tout de suite, car ils veulent continuer la soirée chez des amis. Kim répond que tout va bien et qu’ils peuvent y rester le temps qu’ils souhaitent. Mais le lendemain matin, les deux jeunes ne sont toujours pas rentrés à la maison. Très inquiète, Kim essaie de les appeler au téléphone. Aucun ne répond. Elle se rend alors chez Meg, la mère de Zack, dans l’espoir qu’ils soient chez elle. Mais il n’en est rien. Le barman du pub où ils ont commencé la soirée lui apprend qu’ils sont partis finir la fête dans la belle propriété des parents de Scarlett. Celle-ci lui confirme que la bande de jeunes est bien venue chez elle et que Tallulah et Zack sont restés parmi les derniers. Elle précise même qu’ils sont repartis en disant qu’ils avaient appelé un taxi. L’ennui, c’est qu’aucune des compagnies de taxis de la région n’a chargé de couple à cet endroit cette nuit-là…
Dans la petite ville d'Upfield Common (Grande-Bretagne), un jeune couple, Tallulah et Zack (19 ans), s’offre une soirée de détente au pub du coin pendant que Kim, la mère de Tallulah, garde Noah, leur nourrisson. Assez tard dans la nuit, Kim reçoit un message lui annonçant qu’ils ne rentrent pas tout de suite, car ils veulent continuer la soirée chez des amis. Kim répond que tout va bien et qu’ils peuvent y rester le temps qu’ils souhaitent. Mais le lendemain matin, les deux jeunes ne sont toujours pas rentrés à la maison. Très inquiète, Kim essaie de les appeler au téléphone. Aucun ne répond. Elle se rend alors chez Meg, la mère de Zack, dans l’espoir qu’ils soient chez elle. Mais il n’en est rien. Le barman du pub où ils ont commencé la soirée lui apprend qu’ils sont partis finir la fête dans la belle propriété des parents de Scarlett. Celle-ci lui confirme que la bande de jeunes est bien venue chez elle et que Tallulah et Zack sont restés parmi les derniers. Elle précise même qu’ils sont repartis en disant qu’ils avaient appelé un taxi. L’ennui, c’est qu’aucune des compagnies de taxis de la région n’a chargé de couple à cet endroit cette nuit-là…
« Rentre avant la nuit » n’est pas vraiment un roman policier classique, ni un thriller, ni même un roman noir. Ce serait plutôt un drame sentimental. L’intérêt ne vient pas vraiment de l’enquête en elle-même. Elle piétine tout au long des 454 pages de ce bouquin par ailleurs assez facile à lire grâce à de nombreux dialogues, un style léger et surtout de continuels allers et retours entre l’avant et l’après pour une affaire qui traine sur presque deux années. Pas non plus de fausses pistes, pas de fin surprenante et pas d’accumulation de cadavres si l’on oublie un troisième meurtre en toute fin, bâclé quelques pages, voire un brin invraisemblable d’ailleurs. Madame Jewell a préféré privilégier la psychologie, la description de sentiments, d’états d’âme de personnages assez stéréotypés et s’est complu dans une affaire de romance entre filles aussi paumées chez les riches que chez les pauvres, avec en prime des relations sexuelles saphiques qui tournent mal. Elle qualifie elle-même son style de « cosy ». On pourrait même dire « softly » voire « girly », de sorte qu’on n’est plus très loin de la fameuse « chicklit » qui a un important public dont nous ne faisons pas partie. Les amateurs de « punchy » et de « close to the bone » pourront éviter ce « jewel » (« joyau »). Clinquant pseudo qui peut agacer…
3/5
08:49 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)
04/06/2024
L'eau rouge (Jurica Pavicic)
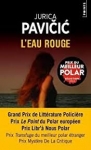 Le 23 septembre 1989, dans la petite ville de Misto (Croatie), une jeune fille de 17 ans, Silva, disparaît sans laisser la moindre trace. La dernière fois que quelqu’un l’a vue ce fut lors d’une fête de village. Elle dansait avec un jeune homme qui n’était pas son petit ami habituel. Quand elle apprend la disparition de sa fille, Vesna, sa mère est effondrée. Elle reste à pleurer des heures entières dans sa chambre. Yakov, le père et surtout son frère jumeau Mate se lancent à sa recherche. La police est prévenue. Des battues sont organisées dans toute la région. En vain. Tout le monde s’interroge : A-t-elle été kidnappée ? L’a-t-on assassinée ? A-t-elle simplement fait une fugue ? Le fiancé est arrêté puis relâché sans être inquiété. Il a un alibi et a résisté au détecteur de mensonges. La famille couvre la région d’affichettes dans l’espoir que quelqu’un quelque part sait quelque chose. Et voilà qu’une jeune femme nommée Elda déclare l’avoir rencontrée le dimanche suivant alors qu’elle-même achetait un billet au guichet de la gare routière. Ainsi débute une très longue recherche qui durera la bagatelle de 26 longues années.
Le 23 septembre 1989, dans la petite ville de Misto (Croatie), une jeune fille de 17 ans, Silva, disparaît sans laisser la moindre trace. La dernière fois que quelqu’un l’a vue ce fut lors d’une fête de village. Elle dansait avec un jeune homme qui n’était pas son petit ami habituel. Quand elle apprend la disparition de sa fille, Vesna, sa mère est effondrée. Elle reste à pleurer des heures entières dans sa chambre. Yakov, le père et surtout son frère jumeau Mate se lancent à sa recherche. La police est prévenue. Des battues sont organisées dans toute la région. En vain. Tout le monde s’interroge : A-t-elle été kidnappée ? L’a-t-on assassinée ? A-t-elle simplement fait une fugue ? Le fiancé est arrêté puis relâché sans être inquiété. Il a un alibi et a résisté au détecteur de mensonges. La famille couvre la région d’affichettes dans l’espoir que quelqu’un quelque part sait quelque chose. Et voilà qu’une jeune femme nommée Elda déclare l’avoir rencontrée le dimanche suivant alors qu’elle-même achetait un billet au guichet de la gare routière. Ainsi débute une très longue recherche qui durera la bagatelle de 26 longues années.
« L’eau rouge » est un roman policier assez particulier. Il ne se passe pas grand-chose pendant plus des trois quarts du récit d’une recherche aussi décevante qu’interminable qui amènera Mate à aller enquêter à Trieste, Graz, Barcelone, Gênes, Ljubljana et même jusqu’à Göteborg pour rien du tout. Dans cette partie de l’ouvrage, l’auteur semble s’intéresser surtout au délitement de la Yougoslavie après la mort de Tito et la fin du communisme dans les pays de l’Est et à celui de la famille de la disparue (divorces, adultère). Ce n’est que dans les tout derniers chapitres que le lecteur aura droit à la clé de l’énigme avec un double rebondissement pas particulièrement crédible qu’il ne faut bien évidemment pas révéler. Pas de plaisir particulier dans cette lecture un peu laborieuse. Pourtant cet ouvrage sans originalité particulière, sans style flamboyant ni humour ravageur, s’est vu décerner rien moins que cinq prix littéraires, ce qui interroge quand même sur la validité de ces récompenses trompeuses qui n’existent peut-être que pour soutenir le marketing.
3,5/5
08:20 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)
31/05/2024
Faux frère (Paul C. Doherty)
 À Londres, à l’époque du roi Edouard 1er, Ragwort, ancien soldat devenu cul-de-jatte et mendiant, dort dans la rue, non loin des potences. Il est témoin de l’égorgement d’une femme en pleine nuit. Puis c’est au tour d’Isabeau la Flamande, ribaude patentée, d’être assassinée chez elle de la même manière, tout comme quatorze de ses consœurs avant elle. L’opinion publique est en émoi. Pour calmer les craintes des bourgeois de Londres, le roi Edouard charge Master Hugh Corbett de mener l’enquête, de très vite retrouver l’assassin et de le faire pendre sans attendre. Il en profitera pour surveiller les agissements de deux agents du roi de France Philippe le bel, de Craon et de Nevers, récemment débarqués dans la capitale. Aidé de son serviteur Ranulf, il découvre que les meurtres ont toujours lieu le treize de chaque mois et que les femmes ont leurs organes génitaux découpés au couteau à l’exception de Lady Somerville. Autre cas particulier : la mort louche du père Bénédict, brûlé vif dans sa chapelle, avec la clé de la porte à la main. Peu de temps auparavant, le religieux avait envoyé une courte lettre au shérif pour l’informer qu’un sacrilège allait être commis prochainement. L’enquête s’annonce difficile. S’agit-il d’une affaire de sorcellerie et de magie noire ? Le tueur est-il un psychopathe haïssant les femmes en général et les prostituées en particulier ? N’y en a-t-il pas plusieurs à retrouver ?
À Londres, à l’époque du roi Edouard 1er, Ragwort, ancien soldat devenu cul-de-jatte et mendiant, dort dans la rue, non loin des potences. Il est témoin de l’égorgement d’une femme en pleine nuit. Puis c’est au tour d’Isabeau la Flamande, ribaude patentée, d’être assassinée chez elle de la même manière, tout comme quatorze de ses consœurs avant elle. L’opinion publique est en émoi. Pour calmer les craintes des bourgeois de Londres, le roi Edouard charge Master Hugh Corbett de mener l’enquête, de très vite retrouver l’assassin et de le faire pendre sans attendre. Il en profitera pour surveiller les agissements de deux agents du roi de France Philippe le bel, de Craon et de Nevers, récemment débarqués dans la capitale. Aidé de son serviteur Ranulf, il découvre que les meurtres ont toujours lieu le treize de chaque mois et que les femmes ont leurs organes génitaux découpés au couteau à l’exception de Lady Somerville. Autre cas particulier : la mort louche du père Bénédict, brûlé vif dans sa chapelle, avec la clé de la porte à la main. Peu de temps auparavant, le religieux avait envoyé une courte lettre au shérif pour l’informer qu’un sacrilège allait être commis prochainement. L’enquête s’annonce difficile. S’agit-il d’une affaire de sorcellerie et de magie noire ? Le tueur est-il un psychopathe haïssant les femmes en général et les prostituées en particulier ? N’y en a-t-il pas plusieurs à retrouver ?
« Faux frère » se présente comme un roman policier médiéval comme en produit la très bonne collection « Grands détectives » de 10/18. Tout comme d’autres auteurs nous plongent dans la Chine ancienne ou d’autres civilisations exotiques, Paul C. Doherty nous propose ainsi un voyage dans l’Angleterre médiévale avec sa sauvagerie, sa cruauté, ses moines paillards, ses ribaudes et autres traine-savates. Des bas-fonds de Londres, le lecteur se retrouvera aussi à la cour d’Edouard Ier et à celle de Philippe le Bel, avec leurs ambitions, leurs rivalités et les intrigues de l’époque (conquête des Pays-Bas). C’est certainement l’aspect le plus intéressant d’un ouvrage bien écrit et très agréable à lire. Plus faible demeure le côté policier. Il ne se passe pas grand-chose avant les deux tiers du texte. L’enquête semble piétiner avant que la clé de l’énigme n'arrive sans tarder. On est loin des finesses d’une Agatha Christie ou d’un Conan Doyle. Doherty a surtout produit un travail d’historien de grande qualité, à l’exception d’un petit bémol de plus d’un siècle sur l’usage du sucre de canne en Angleterre. Et finalement, en note de fin d’ouvrage, le lecteur apprend que toute cette histoire est un fait historique authentique et que même le personnage de Corbett a réellement existé : il s’appelait John de Droxford. Étonnant non ?
4/5
08:57 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)
28/05/2024
Bushcraft, le guide du bovouac pour cuisiner en pleine nature (Dave Canterbury)
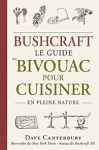 Vivre au plus près de la nature procure souvent un sentiment de bien-être. Pour le citadin pris entre béton et goudron, c’est toujours un plaisir et un certain dépaysement de randonner, de bivouaquer et de cuisiner quelque temps à l’extérieur. Et même de se sustenter de ce qu’il peut éventuellement trouver à disposition. Selon les saisons, quelques cueillettes sont possibles (châtaignes, glands, baies sauvages, champignons, ail des ours), mais chasse et pêche peuvent se révéler aussi réglementées qu’aléatoires. Se déplaçant à pied et ne disposant que d’un sac à dos, notre chasseur-cueilleur 2.0 se retrouve également limité par le poids qu’il peut transporter. D’où la nécessité de fabriquer, avec ce qu’il trouve sur le terrain, le matériel ou les ustensiles nécessaires à son projet. Mais quels sont ceux qu’il doit impérativement emporter, ces cinq objets de survie indispensables au bushcrafteur ? Quels habits emporter ? Quel sac à dos ? Quel matériel de couchage, de cuisine, de chasse, de pêche, etc ?
Vivre au plus près de la nature procure souvent un sentiment de bien-être. Pour le citadin pris entre béton et goudron, c’est toujours un plaisir et un certain dépaysement de randonner, de bivouaquer et de cuisiner quelque temps à l’extérieur. Et même de se sustenter de ce qu’il peut éventuellement trouver à disposition. Selon les saisons, quelques cueillettes sont possibles (châtaignes, glands, baies sauvages, champignons, ail des ours), mais chasse et pêche peuvent se révéler aussi réglementées qu’aléatoires. Se déplaçant à pied et ne disposant que d’un sac à dos, notre chasseur-cueilleur 2.0 se retrouve également limité par le poids qu’il peut transporter. D’où la nécessité de fabriquer, avec ce qu’il trouve sur le terrain, le matériel ou les ustensiles nécessaires à son projet. Mais quels sont ceux qu’il doit impérativement emporter, ces cinq objets de survie indispensables au bushcrafteur ? Quels habits emporter ? Quel sac à dos ? Quel matériel de couchage, de cuisine, de chasse, de pêche, etc ?
Relativement bien illustré de dessins et croquis, cet ouvrage peut être d’une certaine aide pour qui veut se lancer dans cette aventure en milieu naturel, en autonomie et en toute saison. Il fait suite à un autre titre éponyme, plus général, celui-ci s’attachant plus à la cuisine en plein air, mais présentant aussi d’autres aspects de cette discipline assez récemment venue d’outre Atlantique. Selon la définition de Wikipédia, « le bushcraft, plus rarement woodcraft, ou art des bois, est une activité de loisir qui consiste à mettre en pratique des compétences et connaissances permettant de vivre de manière agréable dans la nature, en la perturbant de façon minimale et de la manière la plus autonome possible. ». Un certain nombre de notions et de réalités restent cependant très américaines (animaux, plantes, environnement, réglementations). L’éditeur aurait pu proposer, ne serait-ce qu’en notes de bas de pages, des « adaptations » ou explications pour le public et l’environnement européen, en ne se contentant pas de simplement traduire un texte intéressant, bien écrit et sans doute très utile à qui voudra se lancer à vivre ainsi quelques jours ou plus dans la nature. À noter également la présence de nombreux « Trucs et astuces du Bushcrafteur » parfois peu connus comme ce thé d’aiguilles de pin obtenu en plongeant de jeunes pousses d’épicéa, pin, sapin ou mélèze, mais non de thuya (toxique) dans le l’eau bouillante ou comme ce filtre à eau monté avec les moyens du bord (herbes sèches, charbon de bois, cailloux et sable fin avec éventuelle adjonction d’un filtre à café en papier).
4/5
08:16 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)
26/05/2024
Le chemin des écoliers (Marcel Aymé)
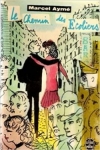 À Paris, pendant l’occupation allemande, Michaud, et toute sa famille subissent avec patience les restrictions alimentaires. Pourtant, un matin, au petit déjeuner, lui et ses deux fils mangent sans le faire exprès, une tartine beurrée de plus que leur part. Du coup, son épouse souffrante et sa fille s’en retrouvent privées d’autant. Avec son associé Lolivier, Michaud s’occupe d’un cabinet de gestion immobilière, affaire devenue nettement moins rentable qu’avant-guerre, en raison des loyers impayés et des appartements inoccupés des Juifs enfuis à l’étranger ou déportés en Allemagne, sans oublier le million de prisonniers de guerre retenus dans des camps. Un des fils, Antoine, à quelques semaines de passer son bac, est devenu l’amant d’Yvette, femme mariée dont le conjoint est détenu en Allemagne. Trafiquant sur le marché noir de tout et de n’importe quoi comme d’une quantité phénoménale de cercueils, le jeune homme gagne déjà fort bien sa vie. Tout comme le fils de Lolivier qui lui, fait déjà partie de la pègre. Michaud a des doutes sur les fréquentations de son fils, alors que Lolivier ne se doute de rien…
À Paris, pendant l’occupation allemande, Michaud, et toute sa famille subissent avec patience les restrictions alimentaires. Pourtant, un matin, au petit déjeuner, lui et ses deux fils mangent sans le faire exprès, une tartine beurrée de plus que leur part. Du coup, son épouse souffrante et sa fille s’en retrouvent privées d’autant. Avec son associé Lolivier, Michaud s’occupe d’un cabinet de gestion immobilière, affaire devenue nettement moins rentable qu’avant-guerre, en raison des loyers impayés et des appartements inoccupés des Juifs enfuis à l’étranger ou déportés en Allemagne, sans oublier le million de prisonniers de guerre retenus dans des camps. Un des fils, Antoine, à quelques semaines de passer son bac, est devenu l’amant d’Yvette, femme mariée dont le conjoint est détenu en Allemagne. Trafiquant sur le marché noir de tout et de n’importe quoi comme d’une quantité phénoménale de cercueils, le jeune homme gagne déjà fort bien sa vie. Tout comme le fils de Lolivier qui lui, fait déjà partie de la pègre. Michaud a des doutes sur les fréquentations de son fils, alors que Lolivier ne se doute de rien…
« Le chemin des écoliers » est un roman social, basée sur une galerie de portraits de gens plus ou moins modestes, plus ou moins compromis avec l’occupant et plus souvent collaborateurs que résistants. Le regard malicieux de Marcel Aymé sur ses personnages est toujours détaché, mais non sans une certaine et juste sévérité. « Qui aime bien châtie bien », dit-on. Il raconte, mais ne juge pas. Le lecteur trouvera dans cet ouvrage des femmes de prisonniers qui trompent leur ennui et leur frustration entre les bras de petits jeunes ou de blonds guerriers teutons, des fortunes obtenues en un temps record grâce à des affaires louches et de petites gens en être réduits quasiment à la misère à cause des privations. Une période particulièrement difficile de notre histoire décrite avec intelligence, finesse et humanité. Le style est toujours parfait et agréable à lire avec une originalité : des notes de bas de page (parfois assez longues) pour décrire le destin, la plupart du temps tragique, de personnages complètement secondaires. Les amateurs d’Histoire, d’humour et de beau langage ne pourront qu’aimer ce charmant opus du grand Marcel !
4,5/5
09:18 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)